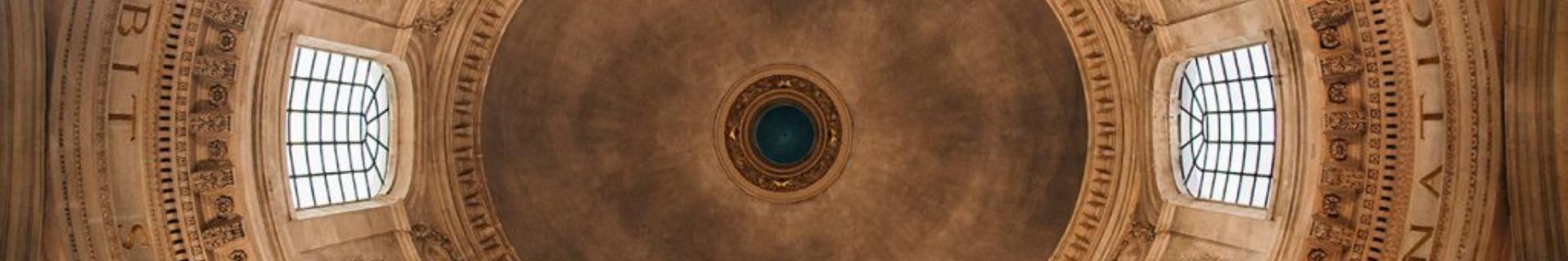
Margaret Thatcher
Philippe Chassaigne, spécialiste de l’histoire de la Grande-Bretagne, analyse l’action politique de Margaret Thatcher.
Communication présentée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le 5 mai 2003.
Philippe Chassaigne, spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne, analyse l'action politique de Mrs Thatcher. De la crise économique, sociale, politique et culturelle que connaît l'Angleterre au début des années 70, il n'hésite pas à parler de "révolution thatchérienne" au moment de l'arrivée au pouvoir de la première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental le 3 mai 1979.

Voici le texte intégral de sa communication :
Le 10 juin 2002, dans une tribune libre publiée par le Times, Peter Mandelson, ancien ministre et proche conseiller du Premier ministre travailliste Tony Blair, déclarait « Nous sommes tous des thatchériens ». Sans doute une lecture attentive montrait-elle que cette affirmation était assortie de quelques nuances : « dans ce sens étroit, et dans le besoin urgent d'affranchir les marchés des rigidités du capital, de la production et du travail, nous sommes tous... ». Il n'empêche : émanant d'une figure de premier plan du parti, l'aveu traduisait bien le caractère essentiel des onze années, de mai 1979 à novembre 1990, passées par Margaret Thatcher au 10, Downing Street. Pour autant, elle a provoqué plus que le lot habituel de controverses qui accompagne l'action de tout dirigeant national elle a suscité admiration sans borne et dénonciations véhémentes, voire haineuses elle est le premier dirigeant britannique à avoir fait l'objet d'une tentative d'attentat (en 1984, à Brighton) depuis celui qui coûta la vie à Spencer Perceval, en 1812. Elle a conduit les conservateurs à la victoire à trois reprises consécutives (1979, 1983, 1987) et son mandat est l'un des plus longs de l'histoire britannique depuis deux siècles. Très vite, on n'a plus parlé de conservatisme, mais « thatchérisme », et on continue encore de le faire, comme on vient de le voir sous la plume de Peter Mandelson or, la personnalisation d'une doctrine politique était quelque chose de littéralement inouï en Grande-Bretagne. On l'a représentée tour à tour sous les traits de Britannia, trident à la main et bouclier au bras, bien décidée à faire entendre la voix de la Grande-Bretagne, sous ceux de la « Dame de Fer », leader autoritaire et inflexible, sinon dénuée de qualités de cœur, ou encore comme une mégère, imposant ses vues, quasi-littéralement, à coups de sac à main. Pour pleinement apprécier l'ensemble de son action, au risque de l'histoire immédiate, il nous faudra voir d'abord la crise profonde dans laquelle la Grande-Bretagne se trouvait lors de son arrivée aux affaires, puis les réponses qu'elle entendit y apporter. Nous tenterons ensuite de faire ressortir les caractéristiques du leadership thatchérien, qui est sans doute le domaine dans lequel nous rencontrerons véritablement le « pire » comme le « meilleur ».
1. LA GRANDE-BRETAGNE A LA FIN DES ANNEES 1970 :
L'« HOMME MALADE DE L'EUROPE »
Les années 1970 sont marquées, en Grande-Bretagne, par une crise à la fois économique, sociale, politique et culturelle.
Crise économique, avec une détérioration constante et accélérée de tous les indicateurs à la suite du premier choc pétrolier de 1973, qui avait aggravé des difficultés manifestes dès la fin des années soixante. Entre 1973 et 1979, la croissance fut inférieure à 1,5%, voire négative en 1974-1975 le nombre des chômeurs augmenta constamment pour arriver à 1,5 million au début de 1979 l'inflation devint galopante, avec une poussée de fièvre à 25% en 1975 et une moyenne annuelle de 10,5% commerce extérieur, paiements courants, budget, accusaient des déficits records. Située au 15e rang des pays de l'OCDE en 1971 (mais au 5e en 1951...), la Grande-Bretagne était tombée au 18e en 1976, année où sa part dans la production industrielle mondiale passa en dessous de 10%, alors qu'elle était encore de 20,5% en 1955.
Crise sociale, ensuite, avec, d'une part le retour du chômage de masse, qui avait disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais aussi, d'autre part, une agitation sociale endémique : près de 15 millions de journées de travail perdues pur fait de grèves en 1974, encore 10 millions en 1977-1978, 30 millions en 1979, du fait du célèbre « hiver de la grogne » (Winter of Discontent) du début de l'année, au cours duquel des grèves tournantes mobilisèrent transporteurs routiers, cheminots, employés municipaux, éboueurs et jusqu'aux fossoyeurs, et paralysèrent littéralement le pays.
La crise était aussi politique : face aux syndicats, forts de leurs 13 millions d'adhérents (un chiffre record), l'impuissance gouvernementale était toujours plus évidente. Ces conflits du travail à répétition avaient pour cause la volonté du gouvernement de modérer des revendications salariales sans rapport aucun avec une productivité poussive, ce qui obéraient la compétitivité de l'économie nationale. L'« hiver du mécontentement » avait montré que le vrai pouvoir s'exerçait à Congress House (siège du Trades Union Congress) et non plus au 10, Downing Street. D'ailleurs, le gouvernement Callaghan (1976-1979) ne disposait plus de majorité à la Chambre des communes. Les libéraux et les partis nationalistes, gallois et écossais, se trouvaient en position d'arbitre : James Callaghan dut conclure en mars 1977 un accord avec les premiers pour obtenir une majorité aux Communes la dissolution du « pacte Lib-Lab » (Liberal-Labour), l'année suivante, le mit sous la dépendance des nationalistes, et c'est d'ailleurs la défection d'un député écossais qui entraîna la chute de son gouvernement, le 28 mars 1979, et la convocation de nouvelles élections.
Crise culturelle enfin, avec le sentiment d'un modèle de société, édifié par les travaillistes au lendemain de la guerre et perpétué par les gouvernements successifs pendant 30 ans, ayant atteint ses limites : l'État providence, omniprésent et prédateur d'une part toujours plus grande de la richesse nationale (les dépenses publiques représentaient 59% du PIB), n'était plus en mesure d'assurer la croissance économique ni le plein emploi. Comme le ministre travailliste Anthony Crosland le reconnaissait dès 1975, « la fête finie » (the party is over).
On ne saurait donc sous-estimer la gravité de la situation de la Grande-Bretagne à la fin des années 1970. Elle était l'« homme malade de l'Europe » un journaliste influent, Peter Jay, avait forgé le néologisme d'Englanditis (« mal anglais ») et certains économistes se demandaient si on n'assistait pas à un phénomène de « retrovelopment » (« développement inversé »), par lequel l'ancien « atelier du monde » serait en train de prendre la voie du sous-développement.
2. UNE « REVOLUTION THATCHERIENNE » ?
C'est dans ce contexte que Margaret Thatcher mena les conservateurs à la victoire le 3 mai 1979 (44% des voix et 339 élus, contre 37% aux travaillistes et 269 élus), devenant le lendemain la première femme à diriger le gouvernement d'un pays occidental. Le nouveau Premier ministre était assez peu connu de ses concitoyens : elle dirigeait le parti conservateur depuis 1975 seulement et n'y avait pas auparavant occupé de poste véritablement de premier plan. Née en 1925 à Grantham, petite ville du Lincolnshire, Margaret Hilda Roberts (Thatcher est son nom de femme) avait fait ses études à Oxford elle avait débuté en politique en 1950 et s'était fait élire en 1959 à Finchley, circonscription suburbaine du nord-est de Londres. En 1970-1974, elle fut ministre de l'Education nationale dans le gouvernement Heath, avant de lui succéder, un peu par surprise, à la tête du parti l'année suivante. Se décrivant elle-même comme « un dirigeant politique de convictions » (a politician of conviction), elle entendait mettre en pratique un programme, appuyé sur quelques principes fondamentaux, pour enrayer le déclin du pays.
Les fondements théoriques
La principale intéressée disait proposer, non « une doctrine, mais un mode de vie », qui devait beaucoup au simple bon sens et aux valeurs de son milieu d'origine : appartenant aux classes moyennes - son père était, c'est bien connu, un « épicier » et un élu local -, Margaret Thatcher avait été élevée dans les valeurs « victoriennes », magnifiant le travail, l'esprit d'initiative, la famille et la nation elle y voyait la clef de la réussite britannique au XIXe siècle et, dans leur oubli, la cause première des maux que son pays traversait. Ces valeurs différaient assurément de ce que l'on a pris coutume d'appeler le « consensus d'après-guerre », qui avait prévalu de 1945 au milieu des années 70 : consensus avec les syndicats, consensus sur le maintien des prérogatives de l'État dans l'économie, consensus, enfin, autour de la protection sociale, par le biais de l'État providence, mis en place par les travaillistes en 1946.
Les vues de Margaret Thatcher étaient radicalement opposées : elle prônait le libre jeu du marché et, à la différence des keynésiens, voulait mener la lutte contre l'inflation avant celle contre le chômage l'idée d'une fiscalité redistributrice lui paraissait un non sens, des taux d'imposition élevés ayant pour effet principal de décourager l'initiative et de brider la croissance en outre, elle considérait l'existence même des inégalités sociales comme stimulant la mobilité sociale quant aux syndicats, elle trouvait leurs pouvoirs excessifs et contraires à la démocratie. Influencée par les idées des économistes néo-libéraux, tels Friedrich von Hayek et Milton Friedman, elle voulait « refouler les frontières de l'État » et le recentrer sur ses fonctions naturelles : garantie de la monnaie, maintien de l'ordre public et défense nationale.
La « révolution thatchérienne » en action
Ces principes furent rapidement mis en application. « Déréglementation » et « État minimal » devinrent les maîtres-mots de la politique conservatrice. Le contrôle des changes fut aboli, comme celui des prix et des salaires. Le taux maximal d'imposition passa de 83% à 40%, et le taux de base de 33% à 20%. Surtout, le gouvernement engagea une vaste politique de privatisations, portant sur une cinquantaine d'entreprises, qui ramena la part du secteur public dans le PIB passa de 12% à 3%. Elle devait diminuer les dépenses de l'État et lui apporter des recettes nouvelles sans avoir à augmenter les impôts (de fait, le produit des privatisations s'éleva à plus de 28 milliards de livres entre 1979 et 1990), démontrer par l'exemple les qualités du secteur privé, réduire l'emprise des syndicats, très puissants dans le secteur public, multiplier l'actionnariat populaire et constituer un « démocratie de propriétaires » acquise aux conservateurs (en 1990, le nombre des actionnaires s'élevait à 9 millions). Dans la même optique, les deux tiers du parc de logements sociaux furent vendus à leurs locataires, à des prix sensiblement inférieurs à ceux du marché.
En matière de politique sociale, le gouvernement voulait encourager, non l'esprit d'assistance, mais la création de richesse, celle-ci devant « couler goutte-à-goutte » jusqu'aux couches défavorisées de la société (théorie du trickle down). En conséquence, le système d'assistance sociale caractéristique de l'État providence fut réorganisé, en privilégiant les subventions ciblées en direction des « vrais nécessiteux » (truly needy), plutôt que des aides attribuées sans distinction. C'est pourquoi - et il faut ici pourfendre quelques idées reçues - les dépenses sociales n'ont pas diminué entre 1979 et 1990, mais ont été, au mieux, stabilisées autour de 22% du PIB dans l'ensemble des dépenses gouvernementales, elles passèrent même de 42% à 50%. Déduction faite de l'inflation, les dépenses en faveur de l'emploi ont augmenté de 73%, les dépenses de sécurité sociale de 33%, et celles du service national de santé de 34%. On est loin des accusations souvent émises d'un démantèlement de l'État providence !
Margaret Thatcher voulait aussi conjurer à jamais le spectre des grèves ininterrompues des années 1970. Plusieurs lois ad hoc, adoptées à un rythme soutenu (1980, 1982, 1984, 1988) limitèrent les prérogatives syndicales, tel le closed shop (monopole syndical d'embauche), interdirent les grèves de solidarité dans des usines non concernées par un conflit, rendirent les syndicats juridiquement responsables des dégâts occasionnés au cours des grèves et obligèrent les dirigeants syndicaux à consulter la base par des scrutins à bulletin secret avant de déclencher une grève l'élection des dirigeants syndicaux, jusqu'alors contrôlée par les états-majors du TUC, était soumise à la même procédure, de même que le versement d'une contribution des syndicats au parti travailliste, source principale de ses revenus depuis le début du XXe siècle. Ces réformes se heurtèrent d'abord à une vive résistance, avec une multiplication des conflits sociaux qui culmina dans la grande grève des mineurs de 1984-1985 : celle-ci, au caractère insurrectionnel évident, fit figure de « 2e tour social » des élections de 1983, remportées par les conservateurs. Elle s'acheva par la victoire du Premier ministre le mouvement syndical enregistra ensuite un déclin de ses effectifs (10 millions d'adhérents en 1990, ce qui restait tout de même un niveau élevé, rapporté au cas français) et le nombre des grèves diminua sensiblement (moins de 2 millions de jours de travail perdus pour faits de grèves en 1990).
La fin de l'Homme malade ?
Le bilan ce cette politique peut s'apprécier à plusieurs niveaux. Sur le plan économique, les « années Thatcher » ont vu une succession de fluctuations cycliques très marquées, à l'image de ce que le pays connaissait depuis les années 1950 : forte récession en 1979-1982 (mutatis mutandis, l'analogie avec la « thérapie de choc » pratiquée dans les pays de l'Est à la sortie du communisme est assez suggestive), retour de la croissance à partir de 1983 et pendant les cinq années suivantes, nouvelle crise à partir de 1989-1990. Lorsque Margaret Thatcher démissionna de son poste de Premier ministre, pour des raisons autres, que nous verrons plus loin, elle laissait à son successeur, John Major, une situation économique difficile. Toutefois, au-delà des aléas conjoncturels, les réformes structurelles réalisées entre 1979 et 1990 ont permis au pays de connaître, à partir de 1993-1994, une croissance qui ne s'est pas démentie jusqu'à aujourd'hui. Si le parti conservateur a perdu les élections de mai 1997, le gouvernement travailliste de Tony Blair a poursuivi la même politique économique (ce que reconnaissait sans détour Peter Mandelson). On a beaucoup glosé lorsque, en 1987, l'Italie dépassa la Grande-Bretagne en terme de PNB par habitant on a nettement moins réagi lorsque celle-ci rattrapa son retard (en 2001 : 26 300 $/habitant contre 26 200) et, dans la foulée, dépassa la France (26 200$/habitant) la Grande-Bretagne se situe de nouveau au 15e rang des pays de l'OCDE. On rappellera les taux de chômage des deux pays respectifs : 9,1% pour la France, 3,1% pour la Grande-Bretagne. Les Français, du moins certains, se consolent en jugeant que les Britanniques n'ont pas de « vrais emplois » toujours épris d'authenticité, nous avons, nous, de « vrais chômeurs ».
La Grande-Bretagne n'a donc plus rien à voir avec le pays à la remorque financière du FMI qu'elle était il y a 25 ans. Des chefs d'entreprise français s'y installent. La City, dynamisée par la déréglementation du début des années 1980, est l'un des poumons du capitalisme mondial : en 1990, la Bourse de Londres était la 3e au monde, après Wall Street et Tokyo. On ne saurait toutefois nier que cette reprise économique a eu un coût social réel. Le chômage de masse a été une constante du début des années 1980 au milieu des années 1990, culminant à plus de 3,5 millions en 1986 et, de nouveau, en 1993. Les inégalités sociales se sont creusées : entre 1980 et 1990, les 10% les plus pauvres de la population ont vu leurs revenus baisser de l'ordre de 10%, alors que ceux des autres déciles ont augmenté de façon d'autant plus importante que l'on progressait dans la hiérarchie sociale (+4% pour le deuxième décile, mais + 60% pour les 10% les plus riches). Les inner cities, quartiers déshérités des grandes villes (Brixton à Londres, Toxteth à Liverpool, etc.) ont été le théâtre d'émeutes violentes en 1981, 1985 et 1990. La proportion de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté (50% du salaire moyen) était passée de 8% en 1979 à 22% en 1990 comme l'écrivait l'hebdomadaire The Economist en 1994, « grâce aux réformes thatchériennes, les Britanniques appartiennent aujourd'hui à la classe moyenne, ou ils dorment dans des cartons à la belle étoile ». On touche là aux limites de la théorie du trickle down, même si l'image d'une pauvreté « à la Dickens », souvent entretenue complaisamment de ce côté-ci de la Manche, est à nuancer : 50% des « pauvres » disposaient d'une voiture ou d'un magnétoscope, 75% du téléphone.
Margaret Thatcher n'a jamais caché sa préférence pour ce type de société, plus ouverte, mais aussi plus inégalitaire, ce qui dénote un courage politique assez peu répandu. De fait, le thatchérisme se mesure aussi à l'aune des qualités du leadership de la « Dame de Fer ».
3. Le leadership THATCHERIEN : PORTEE ET LIMITES
La première caractéristique du leadership thatchérien est la fermeté des convictions et la vigueur de leur affirmation, même dans des circonstances difficiles : ainsi, lors du Congrès du parti conservateur d'octobre 1980, Margaret Thatcher répondit à ceux qui la pressaient de modifier sa politique économique, « vous ferez demi-tour si vous le voulez. La Dame [i.e. de Fer, son surnom bien connu, cf. infra] ne fait jamais demi-tour » (You'll turn if you want to. The Lady is not for turning). Autre choix affirmé et défendu, celui de reconquérir par la force les Malouines, envahies par les Argentins en avril 1982, au lieu d'attendre un éventuel règlement de la crise par l'ONU, ou encore le renforcement des liens avec les États-Unis - la « relation spéciale » -, qui connut son apogée depuis Churchill et Roosevelt. Outre les points communs entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan, président des États-Unis de 1980 à 1988 (itinéraire politique, positionnement idéologique), le Premier ministre fut sans aucun doute le premier dirigeant britannique depuis Churchill à exprimer sans détour sa croyance en la supériorité intrinsèque d'un modèle culturel anglo-américain. Elle soutint de façon indéfectible les initiatives du président Reagan, lors de la crise des euromissiles (1980-1983), lorsqu'il lança son projet un peu utopique d'Initiative de défense stratégique (1983) ou lors du raid aéroporté contre le colonel Kadhafi (1986). Certes, l'invasion américaine, en octobre 1983, de l'île caraïbe de Grenade, État indépendant membre du Commonwealth, pour y renverser un gouvernement marxiste, suscita sa colère, mais elle n'altéra pas substantiellement les rapports entre les deux dirigeants.
L'étroitesse de ce partenariat anglo-américain était vivement dénoncée par ceux qui auraient voulu voir la Grande-Bretagne préférer l'Europe au « grand large ». On peut imaginer que ses partenaires européens ont gardé en mémoire les discussions des années 1980-1984 portant sur le montant de la contribution britannique au budget communautaire, et la volonté de Margaret Thatcher, trouvant que son pays payait beaucoup plus qu'il ne recevait en retour, de « récupérer son argent ». A peine la question fut réglée en 1984 par l'accord de Fontainebleau, elle repartit en croisade en 1988 contre l'évolution fédéraliste que prenait la CEE. Dans son célèbre discours de Bruges (22 septembre 1988), elle déclara sans détour : « travailler plus étroitement ensemble ne nécessite pas que le pouvoir soit centralisé à Bruxelles ou que les décisions soient prises par des bureaucrates non-élus. Nous n'avons pas réussi à repousser les frontières de l'État en Grande-Bretagne pour les voir réimposées au niveau européen, avec un super-État européen exerçant sa domination depuis Bruxelles ».
Ses prises de position l'ont faite décrire, au mieux comme « la gaulliste de Grantham », au pire comme une pasionaria anti-européenne. « Gaulliste de Grantham », en raison de son attachement à la souveraineté nationale, qui faisait écho au plaidoyer du général en faveur de l'Europe des patries s'il est toujours délicat de solliciter les morts, on peut néanmoins imaginer qu'il aurait été sensible à l'attachement thatchérien à l'identité des États, et sans doute moins au renouveau de la « relation spéciale » anglo-américaine. C'est pourtant oublier que la position de Margaret Thatcher était dans le droit fil de celle de ses prédécesseurs (à l'exception de Ted Heath en 1970-1974), instinctivement hostiles devant le caractère supranational des institutions européennes mises en place depuis la naissance de la CECA en 1950 en 1975, le gouvernement travailliste de Harold Wilson avait même consulté la population britannique par référendum pour savoir si le pays devait rester ou non dans la CEE, deux ans seulement après y être entré - l'objet du litige était, déjà, une question de contribution de la Grande-Bretagne au budget communautaire. Margaret Thatcher n'eut jamais recours à un tel procédé elle n'était pas anti-européenne, mais opposée à une Europe politique fédéraliste et à son incarnation archétypique, la monnaie unique elle lui préférait la vision alternative d'un espace de liberté économique assorti d'une coopération intergouvernementale efficace, et le faisait savoir avec toute sa force de conviction.
Un leadership paradoxal pour une femme ?
Le nom de Margaret Thatcher est indissociablement lié du surnom de « Dame de Fer » que le journal soviétique L'Etoile rouge lui décerna en janvier 1976, dans le but de stigmatiser son anticommunisme inébranlable. L'expression devint rapidement au contraire un atout politique, et la principale intéressée savait jouer sur les deux termes : le « Fer », pour l'inflexibilité et la détermination mais aussi la « Dame », car Margaret Thatcher, au risque de l'oublier, était bel et bien... une femme, et cette dimension est évidemment à prendre en compte pour évaluer son action.
Son appartenance au parti conservateur, habituellement peu soucieux d'émancipation féminine, était un élément qui pouvait surprendre. Elle-même, d'ailleurs, ne se préoccupa guère de féminiser le parti, ni le gouvernement on pourrait dire qu'elle était indifférente à ces questions, de même qu'elle elle faisait abstraction de sa féminité, la transcendait en quelque sorte, en prenant les habits de « Premier ministre de Sa Majesté ». La question n'est cependant pas dénuée d'ambiguïté : plusieurs de ses opposants ont reconnu que le fait qu'elle fût une femme les avait amenés à modérer, malgré eux mais de façon quasi-instinctive, leurs attaques à son encontre. Inversement, certaines des critiques qui lui furent adressées - par exemple, son côté autoritaire et chicaneur, ou encore sa propension à imposer ses vues « à coups de sac à main » - étaient, à l'évidence, empreintes de sexisme. On rappellera aussi les deux jugements, par ailleurs bien connus, du président Mitterrand, disant de Margaret Thatcher qu'elle était « le seul homme du gouvernement anglais », mais aussi qu'elle avait « les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn Monroe » (mais, quel aspect préférait-il ? nous ne pouvons que supputer !). Sur le plan du style, la transformation est frappante entre la femme mal fagotée, à la voix toujours prête à déraper dans des tonalités suraiguës, qui entra au 10, Downing Street le 4 mai 1979, et la figure quasi-impériale qui lui succéda en quelque mois, et qui continue encore à délivrer des conférences dans les plus grandes institutions américaines : permanente impeccable, tailleurs élégants de chez Aquascutum, élocution posée grâce à des cours de diction intensifs. A l'évidence, cela contribua à lui conférer une aura incontestable, qui la situe à part tant dans la galerie des Premiers ministres britanniques, que dans celle des leaders conservateurs.
Un grand chef de parti ?
A la différence de la France, le Premier ministre britannique est avant tout un chef de parti. Paradoxalement, le leadership de Margaret Thatcher sur la formation qu'elle dirigea pendant 15 ans (1975-1990) et qu'elle mena à trois victoires successives (1979, 1983, 1987) fut toujours fragile. Ses idées ne firent jamais l'unanimité, notamment parmi les « barons » du conservatisme on se souvient qu'en 1986, l'ancien Premier ministre Harold Macmillan compara les privatisations à « la vente de l'argenterie de famille ». Elle-même avait l'habitude de distinguer entre les dries et les wets, « durs » et « mous », c'est-à-dire ses partisans et ceux qui étaient plus timorés, et de ne compter que sur les premiers. Toutefois, le souci de ménager les équilibres à l'intérieur du parti l'empêcha de jamais constituer un gouvernement peuplé d'une majorité de ses fidèles. D'où de multiples remaniements, qui prirent parfois l'allure de « nuit des longs couteaux », comme pour celui de juillet 1989, au terme duquel neuf personnes seulement, dont Margaret Thatcher elle-même, demeuraient dans leurs fonctions antérieures.
L'atout principal de Margaret Thatcher résidait dans sa capacité à gagner les élections. Encore faut-il souligner que les performances électorales du parti ne furent en rien exceptionnelles : le pourcentage des voix conservatrices déclina d'une élection à l'autre (44% en 1979, 42,5% en 1983, 42% en 1987) et les conservateurs durent leurs larges victoires en termes de sièges à l'effet démultiplicateur du mode de scrutin britannique et à la division de leurs adversaires, entre le parti travailliste et l'Alliance libérale-démocrate, née au début des années 1980. Ils ne cessèrent de perdre du terrain en Ecosse, au pays de Galles ou dans le nord de l'Angleterre, les régions où les problèmes sociaux étaient les plus importants et la « fracture sociale » la plus marquée. En novembre 1990, la réforme des impôts locaux, connue sous le nom de poll tax, que le Premier ministre avait mise en œuvre et qui instituait une taxe d'habitation pesant sur tous les adultes vivant sous le même toit, suscita une levée de boucliers telle dans tout le pays, que Margaret Thatcher cessa d'être un atout électoral aux yeux des députés conservateurs. Ils n'hésitèrent pas alors à la pousser, subtilement mais fermement, à la démission.
Un impact politique considérable
Elle n'en avait pourtant pas moins considérablement modifié le paysage politique britannique, en mettant ses valeurs au centre du débat démocratique. Le parti travailliste, qui s'était dans un premier temps radicalisé à gauche, dut, après trois défaites successives et pour retrouver une chance de revenir un jour au pouvoir, procéder à la fin des années 1980 à un aggiornamento idéologique de grande ampleur : il accepta tour à tour les privatisations, la vente des logements sociaux et l'économie de marché il renonça à prôner le désarmement unilatéral de la Grande-Bretagne. Après une nouvelle défaite en 1992, les travaillistes promirent, en cas de retour au pouvoir, de ne pas augmenter les impôts en 1995, leur nouveau leader, Tony Blair - parfois surnommé Tory Blair -, fit abroger la Clause 4 des statuts du parti (introduite en 1918), qui prônait la socialisation de l'économie. Au terme de ce Bad Godesberg à l'anglaise, le Labour est revenu au pouvoir en 1997.
Paradoxalement, c'est le parti conservateur qui a le plus pâti des onze années de thatchérisme : son successeur, John Major (1990-1997), tenta de se défaire de l'image de créature de Margaret Thatcher qui lui collait à la peau (« Thatcherette »), puisqu'il avait fait toute sa carrière dans son sillage. S'il n'altéra pas les principes politiques de base de son action, il adopta une rhétorique plus consensuelle il n'imposa en revanche ni style, ni idéologie propres (pas de « majorisme » !). La victoire conservatrice aux élections de 1992 fut une « divine surprise », mais il buta ensuite constamment sur les divisions internes du parti entre pro- et anti-européens. Celles-ci, en sus de l'usure du pouvoir et de scandales à répétition, jouèrent d'ailleurs un rôle réel dans la déroute des tories en mai 1997 (30% des voix, soit le plus faible score du parti depuis le début du siècle). Depuis, les conservateurs ne cessent de se chercher une identité politique véritable : ils sont toujours profondément divisés sur la question de la monnaie unique leur audience électorale a littéralement piétiné entre 1997 et 2001 (30% des voix), et on cherche vainement l'apparition d'une « relève » leurs leaders successifs, William Hague (1997-2001) puis Iain Duncan Smith (depuis 2001), manquant, à tout le moins, de charisme. Tony Blair faisant globalement figure de « digne héritier » de la Dame de Fer - il ne s'en défend d'ailleurs que du bout des lèvres -, les conservateurs peinent à trouver une idéologie de rechange. Les perspectives sont donc très sombres pour le plus ancien parti politique britannique.
Margaret Thatcher a-t-elle été un grand chef de gouvernement, mais un détestable chef de parti ? C'est, au moins à grand trait, l'idée qui semble s'imposer si l'on compare, à l'heure actuelle, la situation de la Grande-Bretagne et celle du parti conservateur. On pourra considérer néanmoins qu'il est plus facile de sortir du gouffre un parti politique - l'exemple des travaillistes vient opportunément le rappeler - qu'une nation toute entière. Par son style autoritaire ou son apparente indifférence devant la montée des inégalités, et malgré ses succès électoraux, Margaret Thatcher ne fut jamais vraiment populaire. Pourtant, en réhabilitant la place du marché et de la libre entreprise dans l'économie, la « fille d'épicier » provoqua une véritable révolution politique, et son exemple fut suivi, de façon plus ou moins avouée, par tous les autres dirigeants des pays industrialisés. Ne pourrait-on pas dire, avec Peter Mandelson, que « nous sommes tous des thatchériens » ?
Bibliographie Indicactive
- Leruez, Jacques, Le Thatchérisme, doctrine et action, Paris, 1984.
- Leruez, Jacques, Le Phénomène Thatcher, Bruxelles, 1991.
- Young, Hugo, One of Us, Londres : Pan Books, 1988 (trad. fr. : Margaret Thatcher, Paris : La Manufacture, 1989)
- Kavanagh, Dennis, et Seldon, Anthony, The Thatcher Effect, Oxford : OUP, 1989.
- Kavanagh, Dennis, Thatcherism and British Politics. The End of Consensus ?, Oxford : OUP, 1990.
- Jenkins, Peter, La Révolution de Madame Thatcher, Paris : Laffont, 1988.
- Sergeant, Jean-Claude, La Grande-Bretagne de Margaret Thatcher, Paris : PUF, 1994.
Publications
- Histoire de l'Angleterre des origines à nos jours (Aubier, réed. « Champs », Flammarion).
- La Société anglaise en guerre, 1939-1945 (Messène).
- Lexique d'histoire et de civilisation britannique (Ellipses).
- Industrialisation et Sociétés en Europe occidentale, 1880-1960. Vol. 1, Royaume-Uni et Allemagne-RFA (Messène).
- Pauvreté et inégalités en Grande-Bretagne de 1942 à 1990 (Messène).
- Pauvreté et inégalités en Grande-Bretagne de 1942 à 1990. Textes et documents (Messène).
- Buckingham Palace, Fin de siècle. La monarchie britannique à l'épreuve (Privat).
- Religion et culture dans les sociétés et les Etats européens de 1800 à 1914 (SEDES, en coll.).
- Religion et culture au Royaume-Uni, 1800-1914 (SEDES, en coll.).
- ‘1898 and all that'. Franco-British Relations from Fashoda to Jospin (Macmillan/Palgrave).
- Royaume-Uni/Etats-Unis : la « relation spéciale » 1945-1990 (Atlande).
A propos de Philippe Chassaigne
Philippe Chassaigne, né en 1963, est agrégé d'histoire et docteur de l'Université de Paris-Sorbonne Paris IV. Spécialiste de l'histoire de la Grande-Bretagne aux XIXe et XXe siècles, il est Professeur d'histoire contemporaine à l'Université François-Rabelais de Tours.

Retrouvez sur Kronobase les grandes dates de Margaret Thatcher