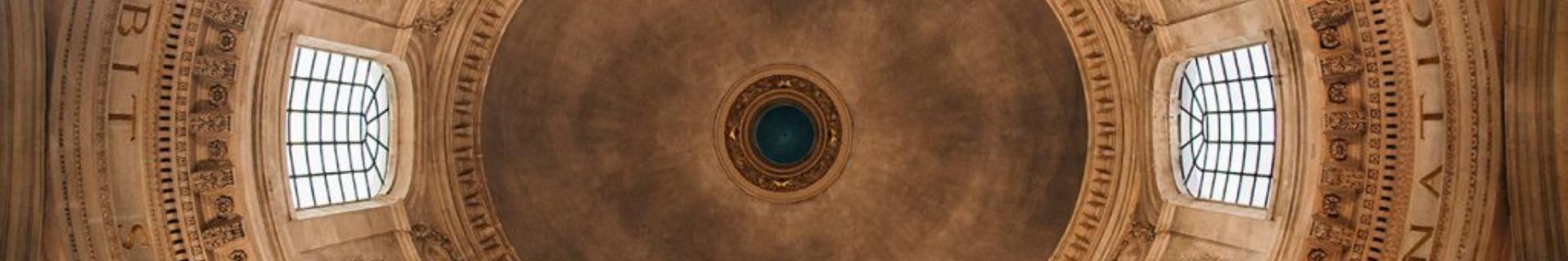
La justice à Port-Royal
Communication de Jean Mesnard présentée en Séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques le 16 janvier 2006.
Pour Jean Mesnard, le problème de la justice à Port-Royal s'y présente sous deux aspects :
- celui de la justice proprement dite, valeur suprême et indiscutée
- et celui des lois qui sont censées la garantir.
La première est simple et facile à définir : elle se résume en deux règles complémentaires : rendre à chacun le même et à chacun le sien. Mais elle est abstraite, et se représente mieux comme une vertu, ou comme un idéal, que comme un objectif pratique.
La seconde se dissout en une multitude de directives, propices à la chicane, et qu'il est aisé de faire s'entrechoquer pour les détruire les unes par les autres. Ce qui pourrait avoir l'effet bénéfique de laisser la place libre à la pure justice, exercée par un juge intègre, situation rêvée par plus d'un jurisconsulte. Mais ce qui risque surtout de se produire, c'est l'ensevelissement de la justice dans le sable des intérêts, avec la complicité de la raison.
Par ailleurs, Jean Mesnard constate presque constamment, à Port-Royal, une reconnaissance de la justice comme valeur absolue. Pour lui, l'attitude minimale, sur ce point, est celle de Pascal, qui découvre en l'homme, même corrompu, une aspiration fondamentale à la justice, demeurée malheureusement vide, quoiqu'elle soit preuve de grandeur.
Mais, le plus souvent, même ce commencement de justice prend des contours plus précis, et il peut aller jusqu'à une sorte d'enthousiasme. Ce qui suppose une limite, ou diverses limites possibles, à la corruption de l'homme par le péché originel. C'est là que la diversité apparaît au sein de la même école.
Voici l'intégralité de sa communication :
C'est à une véritable question-piège que je suis invité à répondre aujourd'hui. La justice en général est déjà l'un des sujets les plus vastes que l'on puisse imaginer. L'envisager dans le cas particulier de Port-Royal semble introduire une limite ; c'est, en fait, un élargissement : car on ne peut bien situer la partie - la justice à Port-Royal - que dans le tout - la justice en général - ; et mon sujet se dédouble ; d'autant plus qu'il faut aussi ajouter l'histoire à la philosophie et au droit. A titre de complication supplémentaire, s'il est un point acquis aujourd'hui concernant Port-Royal, c'est l'extrême diversité des hommes et des femmes qui s'y sont rencontrés, avec, notamment sur le sujet qui nous intéresse, la position tout à fait inclassable de Pascal. Difficile, dans ces conditions, de chercher des principes d'unité et d'agencer les éléments d'un tableau ordonné. Rassurez-vous : j'essaierai quand même de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de distinguer quelques grands axes dans la complexité du mouvement d'ensemble.
La première donnée à prendre en compte est, au fond, celle d'un Port-Royal qui reflète, tout en marquant son originalité, et surtout en imprimant son impulsion propre, l'évolution du XVIIe siècle à partir d'une justice que j'appellerai « humaniste », au double sens d'inspiré par l'antiquité et de soucieux d'humanité, vers une justice que l'on peut désigner comme « classique », avec tout ce que ce terme implique de rationalité. En somme, un mouvement, à beaucoup d'égards, continu, dont il s'agit surtout de saisir le point de départ et le point d'aboutissement. Entre les deux, Pascal, qui, au premier abord, s'insère assez mal dans le mouvement ainsi défini, où il risque d'être considéré comme une sorte de corps étranger, venant brouiller l'action comme un brûlot dans un combat naval, et qui, en définitive, se révèle surtout porteur d'une pensée radicale, mais parfaitement équilibrée, moyennant distinction des ordres. Par respect pour la chronologie et par désir de souligner son importance, il sera présenté dans la partie centrale de l'exposé.
Avocats et magistrats aux origines de Port-Royal
Si l'on réduit Port-Royal à un certain augustinisme théologique, et notamment à une certaine conception de la grâce, issue de l'Augustinus de Jansénius, on ne peut situer sa naissance comme mouvement avant la publication de cet ouvrage, en 1640, son auteur étant mort deux ans plus tôt. Si l'on y cherche surtout les composantes d'une spiritualité, on peut remonter à quelques années plus tôt, en 1635, lorsque la puissante personnalité de Saint-Cyran s'impose au monastère alors passé de la vallée de Chevreuse au faubourg Saint-Jacques ; ou bien encore un peu plus tôt, à la période de grand rayonnement de Bérulle (+1629), lui-même maître de Saint-Cyran. Mais il ne peut faire de doute que l'entrée de Port-Royal dans l'histoire remonte à une date encore plus ancienne, et très précisément connue, celle de la réforme du monastère, alors établi aux Champs, sur l'initiative de sa toute jeune abbesse, Angélique Arnauld, en 1609. En somme, Port-Royal relève d'abord de la renaissance catholique en Europe et en France au début du XVIIe siècle, et de ses effets, alors à peine amorcés, sur les monastères cisterciens. Tout ce qui suivra ne sera que péripéties, souvent importantes, mais moins essentielles.
En la Mère Angélique, nous n'avons pas seulement à considérer son envergure personnelle, mais tout ce qu'elle doit à son milieu, et d'abord à sa famille. C'est une famille de gens de justice, parmi les plus éminents et les plus représentatifs de leur temps. Certes ils n'ont pas soutenue l'abbesse dans sa volonté de réforme, mais ils se sont bien vite associés au mouvement qu'elle avait déclenché, en procédant tous à une véritable conversion spirituelle. Aussi, en dépit de cette divergence momentanée, l'abbesse et le monastère qu'elle conduisait ont-ils été profondément marqués par l'esprit dont ils étaient porteurs, et dont beaucoup de traits concernent directement la justice.
Le père de l'abbesse, Antoine Arnauld - il portait le même prénom que son dernier fils, le fameux théologien - était avocat, et fier de l'être. Ses talents de juriste et d'orateur devaient le conduire jusqu'aux plus hautes fonctions, dont celle de procureur général de la reine Catherine de Médicis. Il avait épousé la fille d'un autre avocat célèbre, Simon Marion, qui devint avocat général au Parlement de Paris. Les deux familles n'en faisaient qu'une, d'autant qu'elles habitaient la même maison, près de l'église Saint-Merri. Beau-père et gendre partageaient en grande partie les mêmes activités, notamment auprès du roi Henri IV, leur protecteur, et comme conseillers privilégiés de deux grandes familles, les Montmorency et les Gonzague, deux familles catholiques modérées, comme ils l'étaient eux-mêmes, en cette époque de passions vives. Ils étaient d'ailleurs tous les deux animés d'un même esprit, largement répandu dans toute la robe, et qui tient surtout dans la haute idée qu'ils se faisaient de la justice - ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient toujours fidèles à leurs principes. Plus précisément que dans leurs écrits, surtout formés de plaidoyers, cet esprit peut être saisi par le truchement d'œuvres littéraires un peu plus anciennes, mais issues de milieux proches, comme les écrivains de la Pléiade ou les familiers des académies royales au temps des Valois. Pour atteindre les racines de notre sujet, il faut donc remonter encore plus haut que je ne l'ai jusqu'ici suggéré.
Il est intéressant par exemple de se reporter à l'Hymne de la justice publié par Ronsard en 1555 ou, mieux encore, à des Discours au Roi (ils sont adressés à l'éphémère roi François II, mais le propos s'étend bien au-delà de sa personne), discours composés par Du Bellay en 1559, peu avant sa mort, et mentionnés expressément dans les Plaidoyers de Marion. L'hymne de Ronsard fait de la justice une sorte de bien suprême dans un univers qui, sans elle, demeure chaotique. Quant aux Discours de Du Bellay, il en est un qui témoigne de relations étroites avec Michel de L'Hospital, futur chancelier de France, l'un des magistrats les plus respectés du temps. Un autre, décrivant les « quatre états » du royaume de France, variante des « trois états » de la classification traditionnelle, fait de l'un d'eux, celui de la justice, manifestement constitué avec la partie de la noblesse dite noblesse de robe, comprenant surtout les magistrats, et la partie du Tiers Etat que représentaient la plupart des avocats. Ce regroupement de toutes les parties prenantes de la justice met remarquablement en valeur son autonomie et sa dignité. De plus, cet « état » est dépeint comme tout à fait essentiel à la monarchie, tout à fait royal. Dans une France qu'il déclare « mère des arts, des armes et des lois », peu s'en faut que le poète ne tienne le troisième terme pour le plus important, comme celui qui fait subsister tous les autres. Mais ce qui permet surtout de lui attribuer une place éminente dans la préhistoire de Port-Royal, c'est la conception qu'il se fait d'une justice essentiellement morale, dont l'exercice est représenté sur le modèle de la conversion intérieure, comme exigeant sans cesse le retour à un ordre que la vie tend à corrompre, ordre à réaliser dans la conscience du juge, qui doit être d'abord un juste, même quand il est roi, aussi bien que dans les actes de justice qu'il accomplit. De plus, cet ordre à réaliser découle d'une norme qui est une origine, et qu'il faut donc, non pas inventer, mais retrouver. La réforme accomplie par la Mère Angélique à Port-Royal se réglait sur ce modèle, qui est juridique. De même, beaucoup des grands esprits qui ont adhéré à l'esprit de Port-Royal et ont participé à son œuvre créatrice ont partagé cette idée de la justice et l'ont exprimée, en plein XVIIe sioècle, en des termes qui rappellent beaucoup ceux, exemplaires, de Du Bellay. C'est le cas de l'abbé de Saint-Cyran dans une lettre à son ami et disciple Jérôme Bignon, avocat général au Parlement de Paris. C'est le cas du premier et du plus illustre des fameux solitaires, l'avocat Antoine Le Maistre, issu des Arnauld. Grand humaniste, il s'intéressait vivement aussi aux antiquités françaises, dans le ligne d'Etienne Pasquier, notamment comme trésor d'exemples et référence fondamentale. Il est de ceux qui, autour du monastère, ont célébré saint Louis, le louant comme roi justicier, et praticien d'une justice particulièrement pure. C'est lui qui, sur le même sujet, a déterminé les très savantes recherches de Le Nain de Tillemont, mises en forme en 1688 par un disciple de Pascal, Filleau de La Chaise.
Pour revenir à Du Bellay, il est pourtant un point que ses Discours n'abordent pas, sans doute parce qu'il n'était pas encore tout à fait d'actualité, et qui le deviendra durablement, surtout dans le milieu parlementaire et par l'intervention d'Antoine Arnauld, dans un procès tenu en 1594, c'est celui du jugement à porter sur l'œuvre des jésuites. L'ordre, comme l'on sait, avait été fondé en 1540 et avait aussitôt manifesté un extraordinaire dynamisme, réussissant à s'implanter dans toute l'Europe catholique et se proposant d'étendre partout la gloire de l'Eglise romaine et l'autorité du pape. Ce qui soulevait des problèmes politiques, concernant la vieille rivalité du sacerdoce et de l'empire, mais aussi des problèmes juridiques. Notamment celui, fondamental, du rapport entre l'ancien et le moderne. La justice repose-t-elle sur des normes primitives, auquel cas elle ne peut consister que dans un retour perpétuel à cet état ancien, en somme un esprit de réforme ? C'est ce qui découle de la tradition qui a inspiré Port-Royal. De son côté, le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, se flatte de ne pas vouloir réformer, mais former, et il le prouve en multipliant les collèges. Autrement dit, il se veut moderne : la justice résulte d'une création dans le présent, et elle se doit de consolider l'Eglise constituée. Le conflit ne tarda pas à naître entre les citadelles de la tradition qu'étaient le Parlement et l'Université de Paris, et les collèges des jésuites propagateurs d'un esprit nouveau.
La crise de la justice qui se manifeste de cette façon se double d'une autre, bien illustrée aussi à la fin du XVIe siècle chez le théoricien politique Jean Bodin, comme dans les Essais de Montaigne. On se reportera surtout, chez ce dernier, au chapitre intitulé De l'utile et de l'honnête, qui vise manifestement, sous le couvert d'une distinction empruntée à l'antiquité, la pensée politique, mais aussi juridique, de Machiavel. L'honnête désigne ce qui est conforme à une justice pénétrée de morale. L'utile est ce qui va dans le sens de l'intérêt, soit par l'efficacité, soit par les avantages rendus possibles. La conciliation, plus ou moins boiteuse, entre la justice et l'intérêt est irrémédiablement appelée par un monde moderne soucieux d'action et de progrès, et dont Machiavel prend fortement en compte la nouveauté. Elle est récusée par Montaigne, qui se veut fidèle à une exigence de justice intérieure. Il est évident qu'à Port-Royal, la seule justice authentique est aussi celle de l'honnête, enrichi de considérations religieuses.
On comprendra aisément que ces deux crises aient conjugué leurs effets, notamment dans les premières querelles qui ont attiré l'attention sur Port-Royal.
La plus ancienne, évoquée notamment dès le procès de 1594 et souvent reprise par la suite, est celle du régicide. Est-il permis de tuer un roi hérétique, ou fauteur d'hérésie ? Bel exemple de conflit entre un principe juridique fondamental et la préservation d'un bien tenu pour essentiel. Un certain nombre d'auteurs jésuites ont tenté de donner à la question une réponse positive. Les divers attentats fomentés contre la personne d'Henri IV ont amplement donné matière à des débats sur le sujet, qui ont évidemment rebondi lors de l'assassinat du roi, et qui duraient encore au temps de Richelieu. Dans le milieu de Port-Royal, un Saint-Cyran s'y est trouvé mêlé. Le Pascal des Provinciales y fait allusion.
Politique et juridique à la fois fut la grande querelle suscitée, lorsque Richelieu eut pris le pouvoir en 1624, par l'action diplomatique et militaire du ministre, qui préféra conclure des alliances avec les princes protestants d'Allemagne, à l'avantage de la puissance française, plutôt que de favoriser l'entente entre nations catholiques. On sait que Richelieu vit se dresser contre lui le « parti dévot », guidé par le cardinal de Bérulle et dont l'esprit fut entretenu après sa mort par son ami Saint-Cyran. Il existe des affinités indiscutables entre Port-Royal et la parti dévot : elles se prolongèrent, pour des raisons où la justice avait grande part, jusqu'au temps de la Fronde, où Port-Royal commençait à manifester tout son éclat.
Saint-Cyran avait alors disparu, en 1643, à peine libéré de la prison de Vincennes, où Richelieu l'avait enfermé en 1638 : première grande menace contre Port-Royal. Dans l'attitude du ministre, difficile à bien expliquer, entraient, outre des motifs purement politiques, des considérations théologiques. Un grand conflit, relatif à la pratique religieuse et au sacrement de pénitence, opposait alors les tenants de l'attrition et ceux de la contrition. Pour obtenir le pardon des péchés, suffisait-il d'un regret inspiré par la crainte de l'enfer (l'attrition), ou fallait-il être inspiré par l'amour de Dieu (contrition) ? Saint-Cyran, suivi bientôt par son disciple le jeune Antoine Arnauld, et par tout Port-Royal, prêchait la contrition. En face, les partisans de l'attrition formaient le grand nombre. Richelieu fut prodigieusement agacé par cette dispute. Il ne devinait que trop bien les arrière-pensées de ses adversaires, prompts à le taxer de machiavélisme, et qui voulaient prêter un caractère peccamineux à sa politique anti-espagnole. S'il tenait à l'attrition, ce n'est pas tellement qu'il fût inquiet pour son propre salut, mais parce qu'il devait tous les jours gagner à ses vues un Louis XIII terriblement scrupuleux. « Condamner tant d'Espagnols à la mort », selon une formule de Pascal, pouvait-il être impliqué dans une juste déclaration de guerre ? L'attrition, commandée par un intérêt personnel, fût-il reporté à l'au-delà, pouvait-elle faire le poids devant une contrition commandée par un amour de Dieu qui, en termes non-théologiques, pourrait être dit amour de la justice ?
Je n'ai guère parlé jusqu'ici d'augustinisme, tout simplement parce que le concept n'avait pas encore à nous retenir d'une façon essentielle. Nous y sommes pourtant arrivés. La distinction de l'utile et de l'honnête, celle de l'intérêt et de la justice, entraînant celle de l'attrition et de la contrition, est l'un des fondements de cette doctrine, où les deux attitudes opposées reçoivent le nom d'amour de soi et d'amour de Dieu. L'amour de soi vicie tous les actes qu'il inspire ; seul est pur l'amour de Dieu. Le pessimisme tend désormais à l'emporter sur l'optimisme, qui nous est apparu très perceptible dans la réflexion humaniste sur la justice. Pourtant nous sommes passés de l'un à l'autre par une série de transitions insensibles. Au terme, nous atteignons une sorte de sommet par l'union qui se réalise, dans ce nouveau climat, entre le juridique, le moral et le religieux. C'est le moment de s'arrêter à Pascal.
Le double radicalisme de Pascal et son entre-deux
Bien des pistes précédemment ouvertes auraient déjà pu nous conduire à lui, et notamment aux Provinciales. Nous avons vu quelle matière offraient à la casuistique certains conflits d'ordre juridique : La situation, à cet égard, n'est guère différente, que l'on se place sur le terrain de la justice ou sur celui de la morale, d'autant qu'il s'agit toujours, dans les cas considérés, d'une proportion à établir entre un plus et un moins de morale. A l'inverse, beaucoup de cas traités dans Les Provinciales, concernant par exemple le duel, le meurtre, le prêt à intérêt, présentent une face juridique. Mais, dans les Pensées, Pascal déborde beaucoup plus complètement les situations particulières que prête à examiner l'étude des cas. C'est sous l'angle le plus large qu'il y aborde le problème de la justice. Quoique son ouvrage se propose une fin particulière, la conversion de l'incroyant, il lie la réalisation de ce projet à une réévaluation totale de la situation de l'homme dans la société, dans le monde et dans l'histoire. C'est dans ce cadre qu'apparaît, très amplement, la justice.
Mais, sur ce sujet, la réflexion conduite dans les Pensées présente plusieurs faces, plusieurs moments dialectiques qu'il importe de bien situer les uns par rapport aux autres. Car le point de vue change chaque fois et Pascal ne conçoit la vérité que comme la résultante de plusieurs points de vue complémentaires. Ce mode complexe de composition n'est pas impossible, mais très difficile à reconstituer si l'on lit les Pensées dans l'un ou l'autre des classements adoptés par les éditeurs d'autrefois : les fragments y sont tous présentés comme indépendants et les connexions établies entre eux demeurent arbitraires. Depuis plus de cinquante ans, nous sommes en mesure de porter sur le texte un regard global : aux fragments particuliers nous pouvons en effet superposer des classements fournis par des manuscrits anciens, classements dont on peut assurer qu'ils ont été élaborés par Pascal lui-même - ce qui ne veut pas dire qu'ils soient faciles à interpréter. Deux avantages principaux en résultent pour l'étude particulière que nous avons à mener : les fragments isolés se regroupent dans des sortes de chapitres, c'est-à-dire que chaque texte est pourvu d'un contexte ; et la série des chapitres s'ordonne selon une progression que j'appelle dialectique, où le lecteur est invité à parcourir les étapes d'un itinéraire idéal destiné, selon le dessein d'ensemble de l'ouvrage, à le conduire de l'incroyance à la foi.
Trois des étapes ainsi définies concernent directement le problème de la justice. Deux se rangent dans la partie initiale de l'ouvrage, partie préparatoire du raisonnement apologétique, susceptible d'être définie comme une sorte de critique de l'homme sans Dieu. La première occupe une large place dans un chapitre (terme très approximatif) intitulé Misère. La seconde constitue pratiquement le sujet unique d'un chapitre intitulé Raisons des effets. La troisième, en revanche, appartient à la seconde grande partie de l'ouvrage, où se déroule proprement le raisonnement apologétique, et où se définit peu à peu l'homme avec Dieu. Le chapitre correspondant est intitulé Morale chrétienne, mais il s'agit, si l'on en juge par le texte, d'une morale éminemment sociale, incluant la justice. Ces trois chapitres fournissent très exactement trois points de vue sur le problème de la justice, en progression l'un par rapport à l'autre, sans qu'aucun n'annule les précédents.
Le premier et le dernier chapitre, s'opposant aux deux extrémités de l'ensemble, caractérisent d'une façon significative le point de départ et le point d'arrivée. Ils présentent deux aspects de ce que j'ai appelé le radicalisme de Pascal, l'un négatif, l'autre positif. Le chapitre intermédiaire nous situe dans un entre-deux, dans un univers de relativité, beaucoup plus complexe, mais épousant une réalité humaine elle-même complexe.
Au radicalisme négatif correspondent certains des textes les plus fameux et les plus souvent cités de Pascal. Inspirés du scepticisme de Montaigne dans l'Apologie de Raymond Sebond, ils dénient à l'homme toute capacité d'atteindre la justice. A preuve, alors que la constance et l'unité seraient seules garantes de vérité, la diversité infinie des lois selon les temps et les pays. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà Le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre les actions vertueuses. » Certes, maints grands juristes opposent la permanence des lois fondamentales à l'irrégularité des courumes. Mais où découvrir véritablement cette permanence? A quelle raison se fier pour l'atteindre ? Pascal ne voit pas de mots trop sévères pour les Frondeurs - entre lesquels beaucoup de magistrats de ses amis et beaucoup de gens de Port-Royal, fidèles à l'optimisme juridique des générations antérieures. Quelle autorité reconnaître aux lois fondamentales qu'ils veulent restaurer ? Las sagesse commande simplement d'obéir aux coutumes établies, justifiées par leur seul établissement.
Il existe, en fait, une double face dans ce raisonnement. D'une part, l'impossibilité de reconnaître aucune justice aux lois et aux coutumes. De l'autre, l'impossibilité pour l'homme de ne pas désirer la justice. Les lois établies ne subsistent que par l'aliment qu'elles fournissent à ce besoin. « Qui leur obéit parce qu'elles sont justes obéit à la justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence de la loi. » Mais cette illusion est vitale. Ambivalence qui rend nécessaire le passage à d'autres points de vue.
En définitive, celui qui vient d'être développé a servi d'exemple majeur à Pascal pour mettre en évidence deux caractères qu'il prête à l'homme sans Dieu : sa « vanité », c'est-à-dire son vide, son inconsistance, le contentement qu'il trouve dans de simples apparences ; et sa « misère », c'est-à-dire la distance qui sépare en lui le désir de la réalité, l'idée de la justice de toute norme permettant de la définir.
A cette sorte de vide absolu, constitutif du radicalisme négatif, et résultant de cette absence de normes, ne peut correspondre, pour l'homme avec Dieu, porteur d'un radicalisme positif, qu'une norme absolue. Une norme qui ne peut être le fruit de la raison, disqualifiée par ses limites et ses contradictions, mais que fournit la révélation divine, authentifiée par le raisonnement apologétique dont le chapitre Morale chrétienne fournit comme la conclusion.
La clef du chapitre est fournie par cette norme même, exprimée avec une brièveté qui ne fait qu'en accentuer la force : « Deux lois suffisent pour régler toute la république chrétienne, mieux que toutes les lois politiques. » Ces deux lois sont évidemment celles de l'amour de Dieu et du prochain, communes au Décalogue et à l'enseignement du Christ, et propres à régir à la fois la société humaine et la société religieuse. On peut constater que, si le Pascal proche de Montaigne précédemment découvert nous éloignait de la tradition humaniste, et même augustinienne, de la justice habituellement exprimée à Port-Royal, la nouvelle donnée apparue rétablir parfaitement le lien : la prééminence de l'amour de Dieu est affirmée de part et d'autre. En effet, avec le nouveau point de vue, une sorte de différence d'ordre, au sens pascalien du terme, s'est produite par rapport à l'étape inspirée par Montaigne : d'un point de vue à l'autre, les repères se sont modifiés ; l'insertion de la pensée sur la justice s'est faite dans une autre totalité. Par là même, une lumière nouvelle a jailli.
La critique de l'amour de soi, et l'affirmation de l'amour de Dieu comme seul principe du bien et de la justice sont donc communs à toute la grande tradition de Port-Royal. Ils sont mis en avant plus que jamais dans le chapitre Morale chrétienne. Pour bien faire saisir le rapport entre ces deux composantes de l'être humain, Pascal se sert d'une grande comparaison héritée à la fois de l'humanisme et du christianisme, unissant ainsi à son tour deux sources souvent jointes chez ses devanciers. Il s'agit de la fable des membres et de l'estomac, devenue chez saint Paul la grande idée du corps mystique du Christ.
La société est ainsi conçue comme un corps, où les relations d'équilibre qui fondent la justice sont représentées selon le modèle de l'union entre ce corps et ses membres, union profitable à l'un et aux autres. Une sorte de salut apparaît alors possible pour l'amour de soi, dès lors qu'il participe à une justice qui le rend désintéressé.
En dépit de la rigueur des principes, une sorte de richesse humaine demeure accessible sur les sommets d'une justice radicalement chrétienne. Mais Pascal ne considère sans doute pas que la haute perfection requise par cette norme, rendue encore plus difficile à atteindre par la condition pécheresse de l'homme, et impossible à faire suivre intégralement dans une société nécessairement diverse, puisse animer un corps de lois susceptible d'une application pratique, une justice constituée. Voilà pourquoi il a tenu à proposer encore un autre point de vue sur la justice, plus proche de la réalité et débouchant sur des règles concrètes. Ce point de vue relatif et pratique ne pouvait concerner la situation parfaite de l'homme avec Dieu ; il est donc exposé selon la perspective de l'homme sans Dieu, mais d'un homme qui, tout en faisant son deuil d'une justice parfaite, entend construire un ordre de la société reflétant au moins une image de la justice. C'est un fait que sans s'élever au-dessus du champ de la concupiscence, autre nom de l'amour de soi, l'homme peut procéder à une sorte de bricolage grâce auquel, même si le bien absolu ne peut être atteint, des biens relatifs seront préservés. On pourrait dire aussi, en songeant à la morale provisoire que Descartes a voulu définir pour lui-même, en attendant l'achèvement d'une construction rationnelle totale, que Pascal, doutant de voir la Cité de Dieu se constituer hors de l'autre monde, a voulu réfléchir à une sorte de justice provisoire, à l'échelle purement humaine.
Le chapitre Raisons des effets, où se regroupent la plupart des fragments qui définissent cette justice relative, ou provisoire, ne peut donner lieu ici, faute de temps, qu'à des réflexions sommaires. La seule explication de son titre serait déjà longue. J'en chercherais le fil conducteur dans le fragment suivant : « La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions. La concupiscence fait les volontaires ; la force les involontaires. » En somme, deux réalités pour le moins amorales entrent en jeu dans toutes nos actions, et y déploient un rôle moteur, même dans celles qui sont soumises à la règle de la justice. Or la justice seule n'exerce ni attrait ni contrainte. Plus grave : elle peut être contredite ; et, comme la raison, elle est « ployable à merci ». Pour que la justice soit efficace, il faut donc qu'elle puise ailleurs une vertu qui lui manque. Pascal ne pousse pas l'analyse à propos de la concupiscence, maie il est clair que toute législation, en prévoyant des avantages ou des peines, appelle l'intérêt personnel au secours de la justice. Beaucoup plus poussée, et plus audacieuse, est l'identification de la justice à la force ou, plus exactement, la substitution de la seconde à la première par le moyen du langage : « On appelle justice ce qu'il est force d'observer. » Pascal fait donc bien plus que de reprendre le lieu commun qui veut que la justice soit forte. Il considère que la justice n'est qu'un montage à partir de la force. Et il loue les législateurs qui l'ont pratiqué, les déclarant témoins de la grandeur de l'homme en ce qu'ils lui ont rendu, ne serait-ce qu'en image, une justice perdue.
N'allons pas crier au scandale ; n'allons pas chercher des précédents chez Machiavel ou Hobbes. Et voyons ce dont il est effectivement question. Non pas de la violence, qui nous ferait totalement sortir de la justice. Mais d'une force autorisée, susceptible de mettre fin aux contestations interminables qui débouchent sur la guerre civile, « le plus grand des maux ». La paix, ainsi maintenue, est l'une des valeurs neutres auxquelles conduit cet usage de la force. A l'appui de ses vues, l'un des exemples les plus clairs que propose Pascal est la règle de la majorité, qu'il appelle « pluralité ». Il est juste que la majorité l'emporte ; mais sa justice résulte d'une convention, et non de l'essence des choses ; car son rapport à la minorité n'est pas celui du plus juste au moins juste, mais du plus fort au moins fort. Autre force : celle de la coutume, sur laquelle repose toute l'organisation sociale et, encore une fois, la paix. C'est à l'invention des législateurs, et non au poids des armes, que Pascal fait appel. Pour lui, même la justice imparfaite ne s'accommode pas du crime ou de la faute.
Il existe donc dans les Pensées une théorie complète de la justice ; mais le mathématicien qui en est l'auteur ne l'a pas élaborée en s'aidant du pur raisonnement déductif, pour aboutir à des théorèmes successifs emboîtés les uns dans les autres selon une progression linéaire. Il a dessiné une figure dans l'espace, où les lieux et leur disposition n'ont pas moins d'importance que les réalités et les concepts qui les occupent, et dont les éléments peuvent s'agencer de façons multiples, menant à des conclusions contrastées, mais en remarquable cohérence. Dans le détail de sa pensée, il est certes solidaire de ses contemporains, mais il s'adresse à tous selon les besoins et les moments de son discours, se flattant de les concilier à un degré supérieur et dans la plus totale lumière, comme il le fait sur d'autres sujets dans l'Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne. Aussi bien n'est-ce pas dans la considération du détail que sa pensée a été le plus difficile à assimiler, mais dans la saisie de l'ensemble.
Port-Royal et le classicisme juridique
Sur la question de la justice comme sur d'autres, Pascal brille comme un astre isolé. Il était pourtant loin de vivre en solitaire. Il avait beaucoup d'amis, et qui l'admiraient, notamment à Port-Royal. Il s'imposait auprès d'eux par la conversation plus encore que par les écrits. L'ont-ils bien compris ? On peut en douter lorsqu'on voit de quelle façon, après sa mort, ils ont édité ses Pensées. Ils ont été impressionnés par ses idées sur la justice, mais aussi un peu effrayés par ses audaces. Ils n'appréciaient guère ses complaisances pour le scepticisme de Montaigne, même tempérées par d'autres points de vue. Vis-à-vis de saint Augustin, le poids de la polémique aidant, les plus en vue d'entre eux, Arnauld et Nicole, tendaient à modérer leurs positions, et se laissaient gagner à des formes de rationalisme de plus en plus présentes dans la vie intellectuelle du temps : moins l'aristotélisme que le thomisme et surtout le cartésianisme. Ils se démarquaient ainsi parfois explicitement de Pascal, pourtant sensible aux mêmes courants, ou s'engageaient plus avant que lui dans ces voies nouvelles : une dispute relative aux cinq propositions de Jansénius et à la signature du formulaire les mit tous les trois sévèrement aux prises quelques mois avant la mort de Pascal, en 1662. Peu de temps après cette mort, paraissait un ouvrage caractéristique de cette évolution générale vers le rationalisme, la fameuse Logique de Port-Royal, œuvre commune d'Arnauld et de Nicole et à laquelle Pascal n'avait pas refusé sa collaboration. Dans cet ouvrage, qui s'y serait pourtant prêté, il n'est aucunement question de la justice. Manifestement, il fallait que les Pensées fussent venues à l'horizon pour que le sujet s'imposât de nouveau.
Ce sujet est en effet l'une de ceux qui suscitèrent le plus de réserves chez les lecteurs qui eurent la chance d'avoir sous les yeux les célèbres fragments manuscrits avant leur publication partielle, en 1670. Arnauld et Nicole marquèrent leur réprobation d'une manière discrète, mais évidente. Le premier, consulté par la famille Périer, héritière de Pascal, sur les corrections à apporter à un fragment qui professait, sur la justice, le plus total scepticisme, se prononça pour une suppression pure et simple de ce fragment, assortie de considérations peu amènes sur le goût de Pascal pour Montaigne. Conseil qui fut suivi à la lettre. Nicole appellerait une étude beaucoup plus fine et suggestive. A la fois humaniste, théologien et moraliste, il avait beaucoup d'affinités avec Pascal, mais aussi une forte propension à refaire et à corriger ce que son prédécesseur avait déjà fait, toujours en l'adoucissant. Ainsi pour Les Provinciales. L'année même où parurent les Pensées, au texte desquelles il avait apporté de ces corrections restrictives, il publia un traité De l'éducation d'un prince. concernant à la fois la morale, la justice et la politique. Il y introduisit un écrit de Pascal, les trois Discours sur la condition des grands, texte dont on ne sait où il l'avait trouvé, mais dont l'authenticité est indiscutable et l'intérêt considérable sur la question qui nous intéresse - sans qu'aucun écart essentiel n'apparaisse avec les Pensées. Nicole ne se borna pas à cette publication. Il y joignit un écrit de son crû, un traité De la Grandeur, prenant, sans crier gare, le contre-pied de l'autre. Entre l'écrit primitif et la réponse proposée, la différence est extrêmement significative, à la fois d'un certain radicalisme de Pascal, et d'une tendance, chez Nicole, à la rationalisation et à l'humanisation.
Soit, par exemple, chez le premier, la réponse à une question que l'on pourrait formuler : est-il juste de respecter les grands ? La justice prononce que ce respect doit être proportionné à la grandeur. Or les grands ne possèdent, de par ce qui les a faits grands, aucun mérite particulier. Ils ne sont pas différents des autres hommes. C'est par une série de hasards qu'ils sont parvenus au rang qu'ils occupent. Le respect ne saurait donc s'adresser à leur personne. Il ne leur est pas moins dû ; mais par l'effet d'une convention reçue ; et il s'adresse à leur rang et à leurs titres. En termes plus proprement pascaliens, il y a des grandeurs de nature et des grandeurs d'établissement. Les premières qualifient la personne même ; les secondes sont l'effet d'un ordre établi, et dont la justice tient à ce qu'il est établi. Aux premières correspondent des respects de nature, témoignages d'estime ; aux seconds des respects d'établissement, certaines cérémonies qui sont symboles d'un ordre, mais c'est cet ordre que la justice impose de respecter. « Il n'est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. »
Nicole n'est pas du tout disposé à accepter ce caractère conventionnel, factice et irrationnel des grandeurs. Il se refuse même à mettre une barrière entre l'homme et Dieu, pensant manifestement que la raison peut la franchir. Aussi la grandeur n'est-elle pas l'effet d'un artifice, elle correspond à une réalité en elle-même respectable. Une réalité à la fois humaine et divine, et doublement rationnelle. Si les grands sont dignes de respect, ce n'est pas par le faste qui les entoure. Mieux : « Cest par la part qu'ils ont à la royauté de Dieu, que l'on doit honorer en leur personne C'est par l'ordre dans lequel Dieu les a placés, et qu'il a disposé par sa providence. Ainsi, cette soumission ayant pour objet une chose qui est vraiment digne de respect, elle ne doit pas seulement être extérieure et de pure cérémonie ; mais elle doit aussi être intérieure, c'est-à-dire qu'elle doit enfermer la reconnaissance d'une supériorité et d'une grandeur réelle dans ceux qu'on honore. » Le contraste avec Pascal est éclatant, et souligné. Ainsi est advenu l'ordre classique, loin des tensions, des contrastes et des renversements qui avaient si fortement agité la théorie de la justice.
L'ordre et la rationalité s'établissent aussi dans une littérature plus proprement juridique, qu'il n'est pas toujours possible de situer dans la mouvance de Port-Royal, mais qui en reste très souvent proche, tant les liens entre la robe et le monastère n'ont cessé de demeurer solides, avant d'entraîner, au XVIIIe siècle, des transformations dans lesquelles il n'est pas question d'entrer. Il suffira de s'arrêter à un homme de justice dont les relations avec Port-Royal sont fort bien attestées dès son jeune âge, aux alentours de 1650, un Auvergnat compatriote, ami et disciple de Pascal, auquel il prêta main forte dans ses discussions théologiques avec Arnauld et Nicole, un avocat du Roi - encore un - au Présidial de Clermont-Ferrand : il s'agit du jurisconsulte Jean Domat, qui donna en 1689, avec Les Lois civiles dans leur ordre naturel, le premier traité global et ordonné de la justice. Ouvrage trop négligé, où l'on peut découvrir sans peine, d'un côté l'héritage de Pascal, dont l'œuvre de moraliste l'a inspiré et dont il reprend souvent, en lui conservant son sens, la distinction familière entre l'esprit et le cœur, de l'autre côté, les prémices de Montesquieu, qui a pu puiser chez lui l'expression « l'esprit des lois », qu'il emploie assez souvent, et dont il définit la portée d'une manière apparemment originale : « Toutes les règles, soit naturelles ou arbitraires [c'est-à-dire créées par le législateur], ont leur usage, que donne à chacune la justice universelle qui en est l'esprit. Ainsi l'application doit s'en faire par le discernement de ce que demande cet esprit, qui, dans les lois naturelles, est l'équité, et, dans les lois arbitraires, l'intention du législateur. » Bel exemple de l'art de la définition et de l'ordre constitutif, au premier chef, du rationalisme de Domat.
Il n'est pas question d'entrer dans une présentation très poussée d'un ouvrage pourtant capital. Il suffira de s'interroger brièvement sur ce qui touche vraiment à mon sujet : dans quelle mesure cette grande présentation, analytique et synthétique, de la justice en France, qui revendique ouvertement le patronage du roi Louis XIV, relève-t-elle authentiquement de Port-Royal ?
Il est particulièrement aisé de le saisir sur le terrain de la culture.
Il convient d'abord de replacer cet ouvrage dans la catégorie à laquelle il appartient, celle des livres de pédagogie et de science que l'expérience des petites écoles a suscités autour du monastère, à commencer par les Méthodes de langues de Lancelot, en continuant par la Grammaire générale, la Logique de Port-Royal , enfin la Géométrie inspirées par Arnauld, et en allant jusqu'aux ambitieuses fresques historiques de Le Nain de Tillemont. Un grand corps de droit, aussi novateur que les modèles déjà fournis par les autres disciplines, pouvait compléter ce vaste programme. Il n'est donc pas étonnant que l'auteur des Lois civiles manifeste constamment son souci de pédagogie, son dessein de rendre plus facile d'accès la science des lois : on sait à quelle école il s'est formé.
L'esprit de cette pédagogie est de même origine. On y reconnaît l'influence d'Arnauld et la méthode suivie dans la Grammaire et la Logique. Méthode directement venue de Descartes, et appliquant les démarches de la géométrie, science dans laquelle, à son tour, Domat reconnaît le modèle du bon raisonnement. Il plaide pour l'application au droit de l'ordre des sciences, qui commence par les vérités les plus simples et les plus évidentes et progresse ensuite jusqu'aux plus complexes. Il en découle un « ordre naturel » de l'exposé, qui se calque sur l'ordre des choses mêmes.
Ces règles positives entraînent toutes sortes de conséquences critiques. D'abord à l'égard d'un droit constitué par accumulation de jugements particuliers ou de règles de détail, comme il arrive souvent dans les coutumes, à plus forte raison dans les recueils d'arrêts. Même le droit romain, source principale de l'enseignement universitaire, est jugé sévèrement, à cause de sa présentation par fragments, de la surabondance des commentaires, qui brisent la continuité, et parce que le souci de conserver y prime sur celui d'ordonner. On devine que les collections de plaidoyers auraient pu aussi être attaquées.
Mais, par-dessus tout, le droit ainsi présenté s'éloigne de sa raison d'être, qui est la justice, Elle seule nous ramène à la simplicité de la méthode géométrique. Elle nous enseigne les principes immuables de l'équité, fruit d'une intuition lumineuse que la prolifération indiscrète des lois vient souvent perturber. C'est donc par le recours à la nature, terme essentiel chez Domat, sans laquelle les lois perdraient ce qui les fait lois, c'est-à-dire leur esprit. De même, comme on l'a vu, si l'on considère les lois dans leur globalité, l'important, pour les maîtriser avec exactitude, est de les embrasser dans leur « ordre naturel ».
Dans quelle mesure cette confiance accordée à la nature, confiance d'autant plus remarquable qu'elle est reconnue même aux peuples infidèles, est-elle compatible avec le pessimisme habituel à Port-Royal, avec l'idée de la corruption de l'homme par le péché originel ? Voilà qui nous invite à nous placer sur un nouveau terrain pour juger de l'exacte allégeance de Domat, du moins du Domat touchant à la fin de sa vie, à l'égard de Port-Royal : le terrain de la doctrine.
On a vu, par l'exemple de Nicole, à quel point certaines positions extrêmes illustrées notamment par Pascal, avaient été plus tard atténuées chez certains esprits pourtant très fidèles à Port-Royal. Domat est manifestement dans ce cas, peut-être au point de franchir certaines limites.
L'emprise de l'augustinisme se manifeste pourtant chez lui par la condamnation qu'il prononce contre la concupiscence et l'amour-propre. De ce dernier, il fait « le poison de la société ». Mais en même temps il déclare, ce qui n'est d'ailleurs pas se montrer tout à fait infidèle à saint Augustin - n'oublions pas « etial peccata ! » -, que Dieu sait en faire un remède permettant précisément à la société de subsister, par le développement du travail et du commerce, par la création de compagnies réunissant les hommes entre eux. N'approchons-nous pas tout près de la réhabilitation, fort peu janséniste, de l'amour-propre à laquelle procèderont les économistes du XVIIIe siècle, notamment Adam Smith ? Nous sommes, pour le moins, en pleine ambiguïté.
Revenons aussi sur l'affirmation que l'homme possède la connaissance naturelle de l'équité. C'est la conséquence d'une doctrine clairement affirmée : après la chute, une lumière est restée à l'homme, suffisante pour lui faire connaître les règles naturelles de la justice et de l'équité. C'est la raison qui est porteuse de cette lumière, présente dans tous les esprits malgré les ténèbres que l'amour-propre y a introduites. Une curieuse combinaison se réalise entre l'optimisme humaniste du tout premier Port-Royal et des restes d'augustinisme.
Un dernier point ne fera que prolonger ces remarques. Domat loue beaucoup en l'homme les sentiments d'« humanité » qui l'habitent, c'est-à-dire de tendresse, de compassion, de propension à répondre aux besoins qu'il découvre chez ses semblables : manière de pratiquer la justice jusqu'au point où elle rencontre la charité. De cette attitude, il propose une explication théologique un peu alambiquée : l'amour-propre s'étant substitué en l'homme à l'amour de Dieu, une sorte de confusion s'opère par laquelle chacun est porté à aimer en l'autre ce qui ressemble à sa nature : ce qui semblait dépassement de l'amour-propre, en définitive, y ramène.
On doutera que Domat soit aussi bon théologien que grand juriste. Mais le témoignage de sa vie et de son œuvre apporte un double enseignement. Le premier, qui peut passer pour décevant, que beaucoup d'hommes de Port-Royal, gagnés par les progrès du rationalisme, ont avili et appauvri la doctrine de la grande époque, notamment sur la théorie de la justice. La seconde, dont on se félicitera au contraire, qu'un haut sentiment de la justice, rattaché à la nature humaine la plus authentique, se trouve placé comme clef de voûte dans la grande construction des Lois civiles. On reconnaîtra cependant que raison et sentiment ouvrent la porte à un nouveau siècle.
Pour conclure, il me semble que le problème de la justice à Port-Royal, comme sans doute en beaucoup d'autres écoles, s'y présente toujours, quoique avec des variantes, sous deux aspects. Celui de la justice proprement dite, valeur suprême et indiscutée ; et celui des lois qui sont censées la garantir. La première est simple et facile à définir : elle se résume en deux règles complémentaires : rendre à chacun le même et à chacun le sien. Mais elle est abstraite, et se représente mieux comme une vertu, ou comme un idéal, que comme un objectif pratique. La seconde se dissout en une multitude de directives, propices à la chicane, et qu'il est aisé de faire s'entrechoquer pour les détruire les unes par les autres. Ce qui pourrait avoir l'effet bénéfique de laisser la place libre à la pure justice, exercée par un juge intègre, situation rêvée par plus d'un jurisconsulte. Mais ce qui risque surtout de se produire, c'est l'ensevelissement de la justice dans le sable des intérêts, avec la complicité de la raison. Un ami de Port-Royal disait à peu près que, si la justice avait partie liée avec la grâce, les lois avaient poussé dans le terreau de la concupiscence.
Mais la situation est plus complexe. Comme on a pu le remarquer, on constate presque constamment, à Port-Royal, une reconnaissance de la justice comme valeur absolue. L'attitude minimale, sur ce point, est celle de Pascal, qui découvre en l'homme, même corrompu, une aspiration fondamentale à la justice, demeurée malheureusement vide, quoiqu'elle soit preuve de grandeur. Mais, le plus souvent, même ce commencement de justice prend des contours plus précis, et il peut aller jusqu'à une sorte d'enthousiasme. Ce qui suppose une limite, ou diverses limites possibles, à la corruption de l'homme par le péché originel. C'est là que la diversité apparaît au sein de la même école. Sur la question des lois, on retrouve une diversité comparable, quoique le pessimisme soit davantage de règle, commandé par une méfiance très augustinienne de la raison, créatrice de ces lois ; une raison perturbée par la concupiscence, déguisée en cette folle du logis qu'est l'imagination. Mais, dans le Port-Royal de l'époque classique, une sorte d'humanisme, où les débuts du monastère avaient, pour une large part, pris naissance, est revenu sur le devant de la scène, amenant sans doute des perspectives moins grandioses, mais aussi un paysage moins abrupt.
A propos de Jean Mesnard

Sa carrière
Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé de lettres et docteur ès lettres, Jean Mesnard a été tour à tour professeur au lycée Henri-Wallon à Valenciennes (1946-1947), assistant de littérature française à la faculté des lettres de Paris (1947-1951) puis professeur au lycée Michel-Montaigne à Bordeaux (1951-1952).
En 1952, il devient professeur de littérature française à l'Université de la Sarre (1952-1956), avant de devenir en 1956 maître de conférences à la faculté des lettres de Bordeaux où il est élu professeur titulaire en 1965, poste qu'il occupe jusqu'en 1969.
Il poursuit sa carrière comme professeur à l'université de Paris-Sorbonne de 1969 à 1990, où il est directeur de l'UER de littérature française de 1980 à 1984. Il est professeur émérite puis honoraire depuis 1990.
Jean Mesnard a effectué de nombreuses missions et conférences en Europe, au Maroc, en Afrique noire, au Canada, aux Etats-Unis au Japon, en Corée, en Thaïlande et en Nouvelle-Zélande.
Jean Mesnard a été Président (1977-1991) puis président d'honneur de la Société des amis de Port-Royal, Président (1978-1984) puis président d'honneur de la Société d'étude du XVIIe siècle et Président de l'Association internationale des études françaises, depuis 1995.
Ses œuvres
- 1951 - Pascal, l'homme et l'oeuvre
- 1960 - Documents du Minutier central concernant l'histoire littéraire 1650-1700 (en collaboration)
- 1962 - Edition critique de Textes inédits de Pascal
- 1964-1992 - Edition critique des Œuvres complètes de Pascal, 4 tomes
- 1965 - Pascal et les Roannez, 2 volumes
- 1965 - Pascal
- 1976 - Edition des Pensées de Pascal
- 1980 - Edition critique de la Princesse de Clèves de Mme de Lafayette
- 1985 - L'Age d'or du mécénat 1598-1661 (en collaboration)
- 1990 - Précis de littérature française du XVIIe siècle (en collaboration)
- 1992 - La Culture du XVIIe siècle
- 1992 - Edition critique de l'Abrégé de la vie de Jésus-Christ de Pascal
- 1994 - Edition critique de l'Entretien avec M. de Sacy sur Epictète et Montaigne de Pascal (en collaboration)
