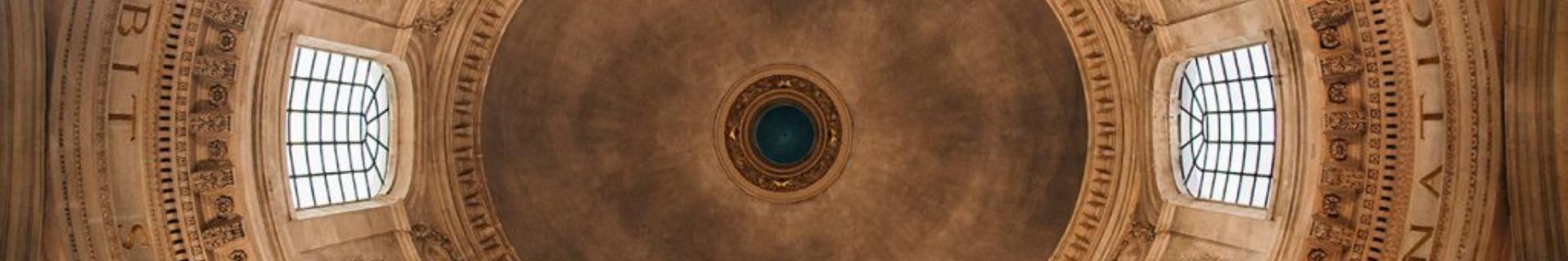
L’erreur judiciaire et sa réparation
Communication de Jean-Claude Magendie, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, prononcée en séance publique devant l’Académie des sciences morales et politiques lundi 6 mars 2006.
Voici le texte de la communication prononcée par Jean-Claude Magendie :
Je ressens comme un immense honneur d'avoir été invité à m'exprimer devant un aréopage aussi prestigieux.
L'accueil de Monsieur le Président André Damien me touche infiniment, lui qui représente, à mes yeux comme à ceux de tous les juristes, l'archétype de l'avocat. Le Bâtonnier Damien incarne la déontologie qu'il enseigne inlassablement depuis de nombreuses années.
Dans votre prestigieuse Maison, André Damien honore à la fois le droit, la langue, les lettres, les arts et l'éthique. La présidence de l'Académie des sciences morales et politiques confère à son œuvre comme à sa vie sa part d'immortalité.
***
Vos lointains prédécesseurs ont entendu, voici cent vingt-six ans, une communication intéressante d'un correspondant de votre Académie, le Professeur Emile Worms. Dans sa séance du 12 juillet 1884, cet historien de l'économie avait traité le sujet suivant : “De l'État au regard des erreurs judiciaires”.
Sous un intitulé à peine différent : “ L'erreur judiciaire et sa réparation ”, c'est en réalité le même thème qui m'échoit aujourd'hui. N'est-ce pas en effet toujours l'État (et lui seul) qui répare les erreurs judiciaires qui ont pu être commises ?
Si, au lieu de vous donner mon sentiment sur cette question, je vous invitais à une relecture de cette communication, vous pourriez vérifier l'étonnante modernité du propos lucide et courageux du Professeur Worms. Certes, le style a quelque peu vieilli et le droit a évolué. Mais, pour l'essentiel, les questions qu'il pose demeurent les mêmes : les juges sont-ils comptables de leurs erreurs ? Notre société répare-t-elle les erreurs judiciaires ? Par quels moyens ?
***
Commençons par dresser un constat : le juge, dans sa difficile mission de dire le droit et le juste, peut se tromper. Cela était vrai en 1884. Cela demeure vrai aujourd'hui.
Comment en irait-il autrement, si l'on veut bien considérer que le droit n'est pas une science exacte, que le juge tranche dans le vif ?
La grande différence entre la situation telle qu'elle se présentait au XIXe siècle et celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est que, désormais, les justiciables n'hésitent plus à mettre en cause la responsabilité de la justice, voire à revendiquer la responsabilité personnelle des juges, même si l'on parle toujours d'une “erreur judiciaire” et non de l'erreur du juge, comme un aveu de ce que l'institution tout entière est en cause.
Par ailleurs, les mentalités ont changé au sein de l'institution. À l'époque où Émile Worms a donné sa communication, la magistrature française voyait d'un mauvais œil que l'opinion publique commence à douter de son infaillibilité.
Ainsi, en 1841, un haut magistrat avait déjà, à l'occasion d'un discours de rentrée, exprimé le regret que la justice ait cessé d'être “une divinité voilée, promulguant ses oracles au sein d'une mystérieuse infaillibilité”[[Léon Laborie, 12 novembre 1841, cité par Jean-Claude Farcy, in : Magistrats en majesté, Les discours de rentrée aux audiences solennelles des cours d'appel (XIXe- XXe siècles), Éd. du CNRS, Paris, 1998, p. 145-146.]].
Quarante ans plus tard (soit deux ans avant la communication de votre éminent correspondant), un autre magistrat déplorait que la justice perde chaque jour “un peu plus de son prestige. De sacerdoce civil qu'elle était naguère encore, elle est descendue au niveau de simple fonction d'un ordre social. Celui-ci construit des chemins ; celui-là perçoit des impôts ; un troisième administre ; le magistrat rend des arrêts. On n'y voit plus de différence. À chacun sa besogne”[[Avocat général Bouchez, Discours du 3 novembre 1881, cité par J.-Cl. Farcy, op. cit., p. 147.]].
Aujourd'hui, les juges ont perdu une grande partie de leur aura et de leur crédibilité dans une opinion publique sous influence, troublée et parfois désorientée par les médias.
Dans la culture victimaire aujourd'hui dominante, toute décision défavorable s'apparente à une mauvaise décision. Elle engendre chez les justiciables à la fois insatisfaction et frustration, et chez le juge le syndrome des mains tremblantes.
Dès lors que leurs demandes ne sont pas accueillies, les consommateurs de justice cherchent à obtenir satisfaction par une autre voie.
Or, le fait, de la part d'un justiciable, de perdre son procès, ne signifie pas que le juge s'est trompé. D'autant que bien souvent (en matière civile en tout cas) le juge ne peut donner raison à toutes les parties au litige.
***
Ne pensez pourtant pas que je cherche à minimiser l'importance de l'erreur judiciaire ou à en méconnaître les conséquences fâcheuses.
Je l'ai admis d'emblée : l'erreur judiciaire existe, quel que soit le souci constant de la plupart des magistrats de tout faire pour l'éviter.
À l'Académie, dans ce sanctuaire des mots, je vais me faire un devoir de définir ce dont je veux parler, à savoir l'erreur judiciaire, dans un premier temps, sa réparation ensuite.
L'erreur judiciaireSi l'on qualifie d'erreur judiciaire toute situation de fourvoiement de l'institution dans une mauvaise voie, les erreurs concernent tout autant la matière civile que le contentieux pénal. Ainsi, pourraient constituer des erreurs judiciaires le refus d'allocation d'une indemnité pourtant due, une mauvaise interprétation d'un contrat civil ou commercial, tout autant que la condamnation d'un innocent.
Mais c'est, le plus souvent, à propos de condamnations pénales que l'on parle d'erreurs judiciaires, sans doute parce que ce sont les plus graves, puisqu'elles touchent à la liberté des personnes. Les juristes eux-mêmes réservent l'expression au contentieux pénal.
C'est ainsi que, dans son Vocabulaire juridique, hortus deliciarum des gens de robe, le Doyen Gérard Cornu définit ainsi l'erreur judiciaire comme une “erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d'une personne poursuivie, peut, si elle a entraîné une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d'un pourvoi en révision”.
Autrement dit, lorsqu'un juge punit un innocent, acquitte un coupable ou encore lui inflige une peine inadaptée, il commet une erreur judiciaire. À condition que cette sanction soit devenue définitive. On perçoit là, déjà, l'importance des voies de recours. C'est précisément parce qu'un juge peut se tromper que notre droit a institué des voies de recours contre les décisions judiciaires, même lorsqu'elles ont été adoptées en collégialité. L'exercice des recours successifs ouverts (offerts, pourrait-on même dire) aux parties devrait permettre aux juges réformateurs de corriger les erreurs d'appréciation qui ont pu être commises lors de l'examen initial de la cause.
Les décisions des juges ne peuvent au demeurant être critiquées que par l'exercice de ces voies de recours. Il en va de l'indépendance de la magistrature. Périodiquement, depuis 1981, le Conseil supérieur de la magistrature le rappelle opportunément : “En vertu du principe fondamental qui garantit l'indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif qu'elles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi”[].
Cela signifie qu'une condamnation prononcée en première instance ne peut pas, juridiquement parlant, être qualifiée d'erreur judiciaire.
Pour éclairer mon propos, permettez-moi de prendre, sans souci de provocation mais seulement de clarté, des exemples qui nourrissent l'actualité.
En toute rigueur de termes, les condamnations prononcées en première instance par la cour d'assises de Boulogne-sur-Mer dans l'affaire dite d'Outreau ne s'analysent pas en des erreurs judiciaires.
C'est bien, au contraire, parce que le jeu normal des voies de recours a pu s'exercer que l'on peut désormais parler des “acquittés d'Outreau”. Ces acquittements manifestent par eux-mêmes que la justice a fini par passer, que la fonction cathartique du procès pénal a, une fois de plus, opéré. Mais il faut quelquefois errer pour aboutir à la découverte d'une vérité. C'est cette errance que le peuple condamne en évoquant, à proprement parler dans un langage qui n'est ni celui de l'Académie, ni celui des juristes, d'une erreur judiciaire.
Si la vérité judiciaire existe, la vérité demeure une énigme, et elle ne se dévoile que progressivement, une fois déjouées les accusations malignes, une fois que le juge a pu vérifier que la vérité ne sortait pas toujours de la bouche des enfants et qu'il a fait le deuil d'une compassion aveuglante.
Le juge ne peut pas faire l'économie du temps, ni d'un cheminement. Le mot même de procédure traduit la nécessité d'avancer pas à pas vers la solution du litige, du procès.
L'opinion publique a trouvé dans l'acquittement, voici quelques jours, des cerveaux présumés de l'affaire Érignac, une nouvelle occasion de dénoncer les errances de la police et de la justice. Mais les juristes pourront légitimement estimer que les lourdes condamnations prononcées en première instance contre les deux hommes ne constituaient pas une erreur judiciaire. La cour d'assises spéciale a, en effet, réformé la décision de première instance en prononçant une décision d'acquittement.
C'est faire peu de cas, me direz-vous, de cette privation de liberté de ceux qui ont finalement été reconnus innocents ! Rassurez-vous : je vais parler dans un instant de la réparation de ce type de préjudice, que notre société s'emploie à favoriser.
La réparation
J'en viens ainsi tout naturellement au concept de réparation. Réparer, au sens où nous l'entendons ici, c'est rétablir, autant qu'il est possible, l'équilibre détruit par le dommage.
Hélas, il est le plus souvent impossible de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. Comment le juge (un homme) pourrait-il réparer l'irréparable ?
Écoutons celui qui se trouvait à ma place en 1884 imaginer le moment de la sortie du bagne du condamné réhabilité à la suite d'une erreur judiciaire :
“Quel est l'homme du peuple ou l'homme de science qui demeurerait impassible devant un pareil spectacle ? Qui ne frémirait pas au souvenir de tout ce cortège de honte, de misères, de tortures, traîné derrière elle par cette fatale méprise judiciaire ? Qui ne se demanderait, tout au moins, si une si grande infortune, ayant été imposée par la société dans sa volonté toute puissante, celle-ci peut, après avoir confessé son erreur, s'en laver les mains sans avoir seulement des regrets à exprimer ?”
La même question se pose aujourd'hui. Même à une époque où, en France en tout cas, une erreur judiciaire ne peut (fort heureusement) plus conduire à l'échafaud, les dommages occasionnés à des innocents injustement privés de liberté peuvent être considérables et absolument irréversibles.
Nul ne peut, en cet instant, éloigner de sa pensée les “acquittés d'Outreau”, comme on peut justement les appeler.
Shakespeare l'exprime avec une grande justesse dans Le marchand de Venise. L'acharnement de Shylock à exiger de la justice la restitution en nature par son adversaire d'une livre de chair qui lui était due en témoigne : il n'est pas de compensation pleinement satisfaisante.
A fortiori, aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne remplacera jamais une absence.
***
Et pourtant, la justice se doit d'indemniser les victimes, et en premier lieu les victimes d'erreurs judiciaires, les victimes d'errances judiciaires, ses propres victimes, pourrait-on dire.
Notre société a confié aux juges le plus puissant des pouvoirs régaliens. Il est normal que l'État en rende compte aux citoyens et offre aux victimes réparation du préjudice qu'elles peuvent avoir subi faute d'un fonctionnement adéquat (par manque de moyens, le plus souvent) de l'institution judiciaire.
Il me faut maintenant envisager d'apporter un éclairage juridique à la manière dont la société organise l'appréciation de la légitimité de la réclamation des victimes d'errances judiciaires et évalue leur préjudice.
J'éviterai de vous infliger ici le détail des règles de droit, et plus encore des règles de calcul, applicables.
Une mission confiée à des juges
On pose volontiers aujourd'hui la question, singulièrement en matière disciplinaire, de savoir qui peut juger les juges Et notre droit de continuer à répondre, à temps et à contretemps : les juges !
Mais quels juges ?
Émile Worms posait déjà la question :
“Il faudra bien (remarquait-il) se mettre d'accord sur la juridiction qui connaîtra des contestations possibles. Car il ne peut-être question ici d'une indemnité fixe et immuable, comme celle qu'allouerait par exemple l'administration des Postes ou des Chemins de fer en cas de perte d'un colis. Et si le particulier lésé ne se contente pas de l'offre qui lui est faite au nom de l'État, des juges seront indispensables. Quels seront ces juges, dont les condamnations pourront constamment venir troubler l'équilibre budgétaire ? On en trouvera toujours, mais il leur faut présenter des garanties suffisantes. Devra-t-on s'adresser aux tribunaux ou juridictions desquels émanent les jugements ou arrêts de condamnation erronée ? Devra-t-on au contraire porter les réclamations d'indemnités devant les tribunaux ou juridictions, chargés par la Cour de cassation de réviser des décisions suspectes, antérieurement rendues ; ou bien la Cour de cassation connaîtra-t-elle elle-même de ces réclamations ?”
Assurément, et pas davantage aujourd'hui qu'hier, il ne peut appartenir aux juges qui ont commis l'erreur de réparer le préjudice susceptible d'en résulter pour les victimes. Dans la mesure, d'ailleurs, où c'est actuellement l'État qui indemnise les victimes, il n'y aurait que des inconvénients à ce que ce soit l'auteur de l'erreur judiciaire qui vienne arbitrer le principe même et le montant de la réparation.
Avant d'envisager les modalités d'une réparation qui paraît impossible, j'aimerais évoquer une question qui fait débat aujourd'hui. Celle de l'impunité prétendue dont bénéficieraient les juges auteurs d'erreurs judiciaires.
Il est exact qu'à la différence du médecin ou d'autres professionnels, qui peuvent être déclarés personnellement responsables de leurs erreurs, le magistrat ne peut voir sa responsabilité engagée directement par des justiciables qui feraient valoir une erreur d'appréciation ou une faute professionnelle de sa part.
La différence est d'importance, assurément. Nombreux sont, d'ailleurs, les membres du corps médical qui ne comprennent pas cette inégalité de traitement dont ils s'estiment victimes.
Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dénoncer cette situation. Et d'interroger :
L'indépendance de la magistrature peut-elle les immuniser définitivement contre toute responsabilité personnelle ?
Cette particularité est-elle digne d'une démocratie, dans laquelle toute personne qui détient un pouvoir devrait répondre de l'exercice de celui-ci ?
N'est-il pas exagéré de considérer que les juges seraient intouchables dans leur activité juridictionnelle ?
Sans prétendre contester toute pertinence à ces interrogations, je voudrais rappeler que la justice judiciaire, en France, répond déjà de ses erreurs et de ses fautes et que le juge lui-même n'échappe pas à toute responsabilité.
Si la particularité de leurs fonctions justifie que la responsabilité des magistrats ne puisse être engagée dans des conditions qui porteraient atteinte à leur indépendance statutaire, interdisant la mise en cause personnelle directe d'un magistrat par un justiciable, les juges ne se situent pas pour autant pas au-dessus des lois et doivent répondre de leurs actes et de leur comportement. C'est la contrepartie de leur indépendance.
Les magistrats se trouvent en effet soumis à quatre régimes distincts de responsabilité : leur responsabilité pénale est susceptible d'être engagée ; ils ne sont pas à l'abri de poursuites disciplinaires ; un contrôle hiérarchique est exercé par les chefs de cours et de juridictions et leur responsabilité civile peut être retenue, dans le cadre d'une action récursoire, pour faute personnelle.
***
La réparation du préjudice subi par les victimes de la justice
La notion d'erreur judiciaire ne connaît qu'une occurrence légale[[L'article 407 du nouveau Code de procédure civile prévoit cependant la possibilité de rapporter une décision "en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue".]]. L'article 626 du Code de procédure pénale prévoit en effet la publicité qu'il y a lieu de donner à un jugement de révision. L'occasion nous est ainsi donnée de souligner que le législateur a voulu prévoir des voies de recours extraordinaires (le recours en révision en est une) envisageant l'hypothèse heureusement exceptionnelle dans laquelle les voies de recours ordinaires n'auraient pas suffi à détourner le juge du chemin de l'erreur.
C'est donc d'abord le droit à un nouveau procès qui a vocation à réparer l'erreur judiciaire déplorée. Mais le législateur va plus loin, qui prévoit qu' “un condamné reconnu innocent a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation”.
Et c'est au détour de l'alinéa qui prévoit les modalités de la publication de la décision d'où résulte l'innocence du condamné qu'apparaît pudiquement l'aveu unique d'une possible erreur judiciaire.
La loi prévoit en effet que ce jugement qui redonne l'honneur peut, si le demandeur le requiert, être “affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celle du lieu de naissance et du dernier domicile connu de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée.”
Le Journal officiel ouvre également ses colonnes à l'annonce d'une injustice réparée, également publiée dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. Toutes ces publications restent évidemment à la charge du Trésor public.
Les erreurs judiciaires sont heureusement rares. Les dysfonctionnements sont plus fréquents, qui entraînent eux aussi un important préjudice avant qu'une décision juste intervienne. Cette réalité a été prise en compte par le législateur qui a organisé deux modalités d'indemnisation des dysfonctionnements judiciaires.
Au sein du livre septième du Code de l'organisation judiciaire consacré aux dispositions communes à plusieurs juridictions, une loi de 1972[] est venue inscrire un titre huitième instituant une “ responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ”.
Cette responsabilité incombe à l'État tenu de réparer le dommage causé par la défaillance du service, que la faute alléguée soit celle d'un magistrat du siège ou du parquet, d'un greffier, ou plus globalement celle du service lui-même.
À côté de cet article L.781-1 du Code de l'organisation judiciaire, qui permet d'indemniser les justiciables qui ont eu à souffrir d'un dysfonctionnement de la justice civile ou pénale, d'autres dispositions inscrites dans le seul Code de procédure pénale servent de fondement à la réparation du préjudice de ceux qui ont été victimes d'une détention provisoire qui n'aboutira pas à une décision de condamnation.
Une telle réparation est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, au bénéfice de la personne qui avait été incarcérée[[Une première loi de 1970 avait permis d'indemniser les personnes placées en détention provisoire et qui - à un stade ou un autre de la procédure - avaient été mises hors de cause, en confiant le soin de statuer sur les demandes à une commission composée de magistrats à la Cour de cassation.]]. Un recours est ensuite possible devant une commission nationale composée de magistrats de la Cour de cassation[].
Depuis l'importante réforme législative intervenue le 15 juin 2000, la réparation intégrale du préjudice moral et matériel ainsi causé est devenue de droit[[L'article 149 du Code de procédure pénale ajoute : "Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites."]]. Émile Worms ne désapprouverait pas le caractère désormais automatique de cette réparation, lui qui proclamait déjà en 1884 :
“Si la prétention à une indemnité, de la part des victimes d'erreurs judiciaires, est dénuée de fondement, elle doit être rejetée sur toute la ligne; mais, si au contraire elle est défendable, si elle peut être élevée à la hauteur d'un principe, l'application de ce principe ne comporte guère de triage, d'expédient, de cote mal taillée, de demi-mesure, et il serait pour le moins singulier que la campagne menée au nom de la justice ne valût aux intérêts en péril qu'une satisfaction trop limitée pour n'être pas dérisoire, tournât à l'inégalité de traitement entre situations à peu près identiques, et fît dès lors crier elle-même à l'injustice.”
Cette procédure est largement utilisée. Ainsi, les différentes commissions de réparation des détentions saisies ont jugé sur l'ensemble du territoire national 121 affaires en 2001, 390 en 2002, 299 en 2003 et 407 en 2004[[Cf. les chiffres-clés de la justice. Les chiffres de 2005 n'ont pas encore été publiés.]].
Dans 80 à 90 % des cas, selon les années[[81 % en 2001, 88 % en 2002, 90 % en 2003 et 91 % en 2004.]], une indemnisation est intervenue. Lorsqu'elle ne l'a pas été, c'est en raison du défaut de preuve du lien de causalité entre la détention et le dommage allégué, ou en l'absence de défaut de justification du dommage.
J'aimerais respectueusement suggérer à votre assemblée de ne point tirer de ces chiffres des conséquences par trop hâtives. Le nombre de victimes indemnisées ne correspond pas, rappelons-le, à autant d'erreurs judiciaires. C'est qu'en effet, le juge peut être tenu de placer une personne en détention provisoire si cette mesure “constitue l'unique moyen” de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, ou encore une concertation frauduleuse.
Le recours à la détention provisoire peut également s'imposer pour protéger la personne mise en examen ou mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
Cette détention (provisoire comme son nom l'indique) n'induit pas une culpabilité certaine. Ce risque, créé par le fonctionnement du service public, l'État doit le supporter même dans des cas qui peuvent choquer l'opinion, peu désireuse de voir les deniers publics affectés à l'indemnisation de personnes qui lui paraissent peu dignes d'intérêt.
Là encore, la toute récente actualité nous en offre un exemple. Fût-il condamné quelques jours plus tôt à une peine de réclusion à perpétuité, un criminel notoire peut se voir allouer une indemnisation significative pour avoir subi quelques mois de détention injustifiés dans le cadre d'une autre procédure n'ayant pas abouti à une condamnation.
Habituellement, les sommes allouées compensent un réel préjudice. Il reste que l'argent ne répare qu'imparfaitement un préjudice résultant d'une privation de liberté.
L'État assume tellement volontiers son devoir de réparation qu'il offre parfois spontanément une indemnisation conséquente, à laquelle ses plus hauts représentants ajoutent parfois des excuses, que les victimes préféreraient recevoir du magistrat présumé responsable du dysfonctionnement, mais qui, pour sa part, se considère plutôt lui-même victime d'un manque de moyens de l'institution.
Offrir à la justice les moyens d'un fonctionnement satisfaisant, comme le préconise au demeurant le premier président de la Cour des comptes[[Philippe Seguin, in Le Monde, 22 février 2006.]], permettrait probablement à l'État d'économiser une partie des fonds affectés à l'indemnisation des victimes des dysfonctionnements de l'institution.
Une question se pose encore ici : comment se fait-il qu'en dépit des dizaines de réformes intervenues en matière pénale au cours du siècle écoulé, on puisse encore rencontrer des erreurs judiciaires ? Ne serait-ce pas, tout simplement, parce que nous sommes des humains ? Comme l'exprime la sagesse populaire, par pudeur en latin, Errare humanum est. Se tromper est sans doute humain. Se tromper pourrait même caractériser l'humanité. Errare, c'est aller à l'aventure, errer, s'écarter de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il est humain que l'homme se trompe ; c'est parce qu'il se trompe qu'il est humain. C'est aussi parce qu'il est un homme, frère des hommes, qu'il doit ne pas s'installer dans l'erreur. Perseverare diabolicum.
L'erreur porte en elle-même un germe de vérité. Gaston Bachelard n'avait-il pas raison d'écrire que “La pensée progresse à coups d'erreurs corrigées ; la science progresse de même ; il n'y a pas de vérités premières, mais seulement des erreurs premières” ?
***
Cette année, nous allons célébrer le centenaire de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Ce sera l'occasion de rechercher les moyens de réparer mieux encore les erreurs judiciaires lorsqu'il n'aura pas été possible de les éviter. L'expérience douloureuse du Capitaine Dreyfus nous permettra cependant de ne pas oublier que la réparation arrive toujours trop tard et qu'elle ne répare décidément pas l'irréparable.