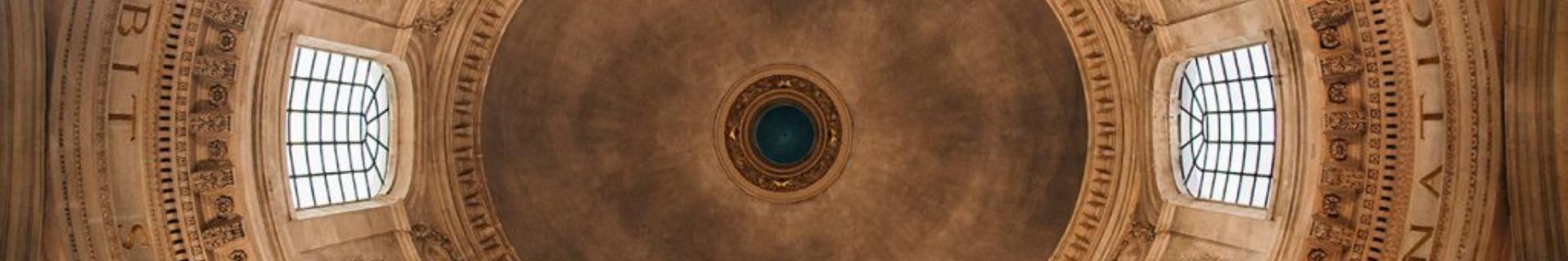
Alfred North Whitehead : sciences modernes et philosophie antique
Alfred North Whitehead, mathématicien, logicien et métaphysicien a su concilier la pensée savante du XXe siècle avec les théories platoniciennes. Une preuve d’érudition qui témoigne surtout d’une fantastique audace intellectuelle. L’académicien Bertrand Saint-Sernin nous présente, dans ce cours magistral, l’homme, son oeuvre et sa pensée.
Whitehead est mathématicien et logicien de profession. Né en 1861, il entre en 1881 à Trinity College, à Cambridge, et y reste jusqu’en 1910. Il enseigne ensuite à l’Imperial College, à Londres. En 1924, il devient professeur de philosophie à l’université Harvard, où il enseigne pendant seize ans. Il meurt aux Etats-Unis en 1947. Son Treatise on Universal Algebra, publié en1898, lui vaut d’être élu en 1903 à la Royal Society. Il est aussi l’un des grands métaphysiciens du XXe siècle.
1. Cosmologie
- Le concept de nature
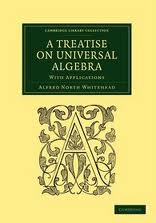
À ses yeux, les modèles que le mathématicien conçoit font partie de l’univers : dissocier idées et choses est une erreur. Il situe les débuts de sa production philosophique juste après la Grande Guerre en 1919. Il publie en 1920 The Concept of Nature où il se pose la question : comment éviter la dissociation (bifurcation) entre le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous pensons ? Dès ses années de classe à Sherbourne, Whitehead admire les poètes de la nature : ainsi, Shelley et Wordsworth expriment, avec la langue et la perception naturelles, ce que chacun de nous, s’il allait au bout de la connaissance commune, pourrait dire de l’univers. Il déclare : « pour la philosophie de la nature (c’est-à-dire pour la science), tout ce qui est perçu est dans la nature ». La dissociation des caractères perçus en qualités premières et en qualités secondes est donc inappropriée. Whitehead, tout en se situant dans la tradition de l’empirisme anglais, s’emploie à surmonter la réduction du monde perçu à la sphère subjective. Que fait la science, en effet ? Elle détermine les caractères des choses connues, c’est-à-dire les caractères de la nature.
Toutefois, élucider le « concept de nature » exige de mettre au jour les relations complexes qui s’expriment à travers les entités que nous percevons et tentons de comprendre. Whitehead ne se préoccupe pas d’explorer les processus par lesquels la perception et la conception des réalités extérieures se forment dans l’esprit : « La compréhension que cherche à obtenir la science est une compréhension des relations au sein de la nature ».
Dans Science and the Modern World (chap. V), Whitehead se demande : pourquoi les poètes de la nature ne sont-ils pas aussi des savants ? Si l’on doit proscrire la dissociation entre perception et science, comment se fait-il que nul poète ne parvienne à s’en affranchir ? Cela veut-il dire que l’approche scientifique du monde ne se confond pas avec son approche esthétique ?
La réponse de Whitehead est identique à celle de Platon dans le Timée : l’homme est devant un choix. Il peut penser :
1) que le monde réel est imprégné d’entités éternelles ;
2) ou que seules existent des réalités sensibles qui se voient, se sentent, se touchent, etc.
Or, dit Platon, nous devons décider sans avoir d’arguments absolument probants en faveur de l’une ou l’autre conjecture. Comme Platon, Whitehead opte pour la première.
- Les deux grands textes cosmologiques
Dans Process and Reality, il déclare que les deux plus grands textes cosmologiques de la tradition philosophique occidentale sont le Timée de Platon et le Scholium de Newton. Il reconnaît que, dans le détail, bien des passages du Timée nous semblent extravagants, mais estime que ces visions imaginatives ne compromettent pas la valeur philosophique toujours actuelle de l’œuvre, à savoir la recherche d’une approche du monde où « l’intelligence et la perception se mélangeraient au point de ne plus faire qu’un » (Lois, 961 c).
Whitehead sait que le programme cosmologique de Platon inspire les penseurs anciens. Pourquoi a-t-il échoué ? La réponse de Whitehead est la suivante : les stoïciens, par exemple, ont raison d’insister sur la solidarité entre les choses (contagio rerum). Mais si chaque entité interagissait avec toutes les autres de façon significative, il serait impossible d’isoler au sein de l’univers des régions relativement indépendantes auxquelles des modèles distincts (géométriques, mécaniques, physiologiques, etc.) s’ajustent. Par chance, plusieurs lois fondamentales de la physique décrivent des actions qui décroissent avec la distance (lois newtoniennes de la gravitation, lois du rayonnement de la chaleur, par exemple). Il devient dès lors possible de pratiquer une approche scientifique de la nature sans être devant l’alternative insoluble d’avoir à tout subsumer sous le même modèle ou d’avoir à renoncer à penser scientifiquement le monde.
- Historicité des sciences
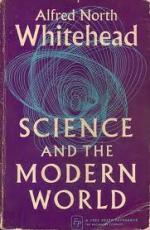
Dans Science and the Modern World, Whitehead étudie comment des disciplines qui se sont développées de façon indépendante opèrent leur jonction et fusionnent des territoires séparés du savoir. Ainsi, dans la 3ème section du chapitre 7 du livre, consacrée aux idées de « champ physique» et de « champ gravitationnel», il déclare que, l’électricité et l’électromagnétisme ayant fait leur jonction grâce aux découvertes de Faraday et de Maxwell, il s’agit à présent de relier la théorie de la gravitation et l’électromagnétisme.
À partir du moment où les phénomènes électriques, magnétiques et gravitationnels seront interconnectés, leurs relations pourront être dites « internes ». On retrouve là une idée voisine de celle des « théories de principes » chez Einstein. Selon le créateur de la théorie de la relativité générale, il existe deux sortes de théories scientifiques : les « théories de principes » qui se caractérisent par leur « perfection interne (innere Vollkommenheit) » et leur exactitude empirique ; et les théories dites « utiles » qui, quoique n’ayant pas une transparence conceptuelle entière, reçoivent de l’expérience une « confirmation externe (aüssere Bewährung) ». Dans les théories du premier type, les relations entre les éléments sont « internes » et, dans une certaine mesure, la relation entre expérience et théorie peut être aussi qualifiée d’ « interne », en ce sens que les idées théoriques (ou les « objets éternels »), d’une part, les faits empiriques, de l’autre, semblent s’ajuster étroitement.
L’historicité des sciences n’est donc pas un accident. Elle exprime les conditions anthropologiques de la connaissance. Platon s’interroge sur les conditions pour que l’esprit se forme des « opinions solides et vraies ». Il faut, dit-il, que le raisonnement « transmette à l’âme entière des renseignements sur le sensible » (Timée, 37 b). Comment éviter, dans ces conditions, que le réceptacle du savoir ne soit pas la partie de l’âme assujettie à une vision tronquée et à des préjugés ?
La purification de la connaissance empirique ne se réduit pas à une ascèse individuelle : c’est un processus de longue durée auquel participent, au long des siècles, une suite de savants. Ainsi, à l’époque de Platon, aucune théorie n’unifie les informations fragmentaires dont on dispose sur les métaux. Celui qui travaille l’or n’a pas les mêmes informations que celui qui travaille le cuivre, l’argent ou le plomb. Ces différences d’informations selon les métiers indiquent que nulle âme n’est prête à recevoir et à parfaire la science des métaux .
En outre, le développement des sciences est traversé de crises plus ou moins rapidement surmontées. Dans les Essays in Science and Philosophy, Whitehead rappelle la réaction de Frege quand Russell découvrit son fameux paradoxe relatif « à l’ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes comme élément ». Le grand mathématicien allemand lui répondit : « Hélas, l’arithmétique vacille ». Comment se fait-il qu’il y ait une histoire des mathématiques, alors que « nous pouvons concevoir aisément une connaissance mathématique soustraite au temps (timeless) » et que, de la même manière, « l’idée d’une connaissance mathématique soustraite à l’espace (spaceless) ne présente pas de difficultés » (ESP, p. 136) ?
Whitehead répond que les entités mathématiques ne peuvent pas être conçues isolément : pour que leur transparence augmente, il faut que leur valeur cosmologique – c’est-à-dire leur lien avec la nature – se renforce. Ainsi, au XIXe siècle, on a pris conscience que la géométrie d’Euclide n’était pas la seule concevable. Les travaux de Gauss, de Lobatchevski, de Bolyai, de Riemann ont eu deux conséquences majeures :
1) établir que la géométrie d’Euclide n’était pas le seul système logiquement cohérent ;
2) montrer que la nature – et, plus particulièrement le continuum spatio-temporel – n’était pas pensable à travers le seul prisme euclidien.
Il y a donc un lien étroit entre logique et cosmologie : la recherche de la cohérence logique ne garantit pas à un système sa valeur représentative, c’est-à-dire sa capacité à représenter fidèlement les processus naturels.
D’où une question : si la connaissance doit reposer sur l’expérience, comment peut-elle aussi tendre à l’universel ? Les objections de Hume sont-elles réfutables ? Dans les Essays, Whitehead engage avec Hume un dialogue et un combat. Il accepte l’argument de Hume selon lequel la partition des caractères des choses en « qualités premières » et « qualités secondes » est fausse. Pourtant, il réfute le solipsisme de Hume : en effet, notre esprit fait partie de la nature au même titre que notre corps, nos perceptions, nos impressions, nos sentiments, nos humeurs. Toutefois, nous ne confondons pas la réalité et les rêves, car nous avons l’assurance d’être ancrés dans un continuum spatio-temporel, total et uniforme.
Si l’univers n’était pas composé de régions relativement distinctes dont on peut étudier les processus de façon séparée, la science serait impossible. En effet, c’est l’existence d’ordres de phénomènes distincts qui rend l’induction légitime. Car induire consiste, sur la base d’observations ou d’expériences, à proposer une hypothèse valable pour tout l’ordre des phénomènes considérés. Il y a donc une rupture entre les expériences, qui forment un ensemble fini, et l’hypothèse, qui est une proposition universelle. Pour conforter sa légitimation théorique de l’induction, Whitehead cite un passage du Treatise on Probability de J. M. Keynes : « […] si les prémisses de notre raisonnement nous autorisent à juger que les faits ou les propositions sur lesquels porte le raisonnement font partie d’un système fini, alors une connaissance probable valide peut être obtenue à l’aide d’un raisonnement inductif ».
En résumé, la cosmologie apparaît comme une tentative pour mettre en évidence le devenir de l’univers. Whitehead dit même : « Presque tout Process and Reality peut être lu comme un essai pour situer l’analyse du périr au même niveau que l’analyse du naître par Aristote ».
2. Anthropologie
La tâche de la cosmologie est de faire comprendre comment le monde de l’action et celui de la valeur fusionnent : « le problème de “l’identité personnelle” dans un monde en devenir est l’exemple clé pour le comprendre » (E, p. 85).
Quelle idée Whitehead se fait-il de l’individu ? Comment conçoit-il l’interaction entre les êtres ? De quelle façon l’aventure humaine s’inscrit-elle dans l’histoire de l’univers ? Whitehead se défie des « theories of bifurcation of nature » : essayer de démonter la machinerie neurophysiologique lui paraît être une façon d’esquiver le problème essentiel de la science, à savoir retrouver les processus objectifs qui sont à l’œuvre dans le réel. Fidèle à Platon, Whitehead veut « pénétrer la nature de l’univers et, partant de la naissance du monde, terminer par la nature de l’homme » (Timée, 27 a).
- Le « réceptacle »
Dans Adventures of Ideas, il s’interroge sur le « réceptacle » où se forment les idées et les actions humaines, sur la base des informations venues de l’univers. Il paraphrase en les modifiant plusieurs passages du Timée (48 c, 49 a, 50 c-e, 51 a, 52 b), où Platon ne décrit ni l’âme du Monde ni l’âme individuelle, mais « expose sa doctrine du Réceptacle (hupodochè) ou lieu (chora), dont la seule fonction est d’imposer une unité aux événements de la nature ». Pour éviter toute confusion entre le « réceptacle » et la notion d’« âme », Whitehead souligne : « Les deux philosophes modernes qui ont rejeté de la manière la plus conséquente la notion d’âme-substance identique à elle-même sont Hume et William James » (AI, p. 244). Il ajoute, car c’est une mission qui lui incombe aussi : « Mais il leur reste, comme à la philosophie de l’organisme, à rendre compte de façon adéquate de cette unité personnelle incontestable qui se maintient à travers la masse confuse des circonstances » (ibid.).
- La tradition empiriste anglaise
Pour Whitehead, la connaissance est une aventure dans laquelle l’individu doit se lancer tout entier ; sans engagement total, l’entreprise reste stérile ; en revanche, les découvertes ne sont pas rapatriables dans l’individu : ni A Treatise on Universal Algebra (qui ne porte qu’une signature), ni les Principia Mathematica (cosignés par Russell et Whitehead), ni les articles actuels qui ont souvent un grand nombre de signataires ne sont enracinés dans une âme individuelle qui serait leur lieu (chora). Pourtant, les idées ne flottent pas en l’air comme des spectres : dans la mesure où elles sont vraies, elles appartiennent à un monde idéal qui est aussi un « modèle » des processus de la nature.
Refuser l’idée de l’âme-substance, c’est, pour Whitehead, dénier à l’âme mortelle (ou au psychisme) une identité séparée et décider que l’âme non-mortelle – le daimôn – nous met en relation avec la créativité de la nature, avec ce qui naît et ce qui meurt.
- La religion
N’est-ce pas confondre cosmologie et religion ? Pour Whitehead, la religion n’est pas l’opposé de la raison : tout au contraire, elle en est l’institutrice, car elle aspire à la justification. Les rituels et les émotions collectives « sont des ornements de la religion » : son essence est de saisir « ce que l’individu fait de sa propre solitude ». Réfléchir sur la religion soulève une alternative : ou bien la religion est une idéalisation de la société et Durkheim a raison ; ou bien, au-delà des sociétés humaines, une réalité transcendante se laisse entrevoir. Whitehead prend le second parti : il s’oppose à la thèse selon laquelle la religion « serait essentiellement un fait social » (ibid). Deux systèmes religieux seulement sont arrivés à maturité : le bouddhisme et le christianisme. Ces « grandes religions rationnelles » (RG, p. 47) sont pourvues de systèmes de représentation et d’argumentation. Leurs dogmes formulent les idées incluses dans l’expérience religieuse de l’humanité et répondent à la question : Que veut-on dire par ce mot : « Dieu » ? (RG, p. 67)
Le concept de Dieu a eu, historiquement, trois expressions majeures : la conception propre à l’Asie orientale d’un ordre impersonnel auquel se conforme l’univers ; la conception sémitique d’une entité individuelle, personnelle, absolue, qui a décrété et ordonne le monde ; la conception panthéiste dans laquelle le monde actuel est « une description partielle de ce que Dieu est » (RG, p. 68-69). Whitehead, dans Religion in the Making (La religion en gestation), en ajoute une quatrième, qu’il explicite dans la quatrième partie de Process and Reality, intitulée « Dieu et le Monde ».
Que Dieu soit ne fait pas de doute puisque, sans lui, l’ordre du monde ne serait pas : chercher Dieu, c’est explorer la « caverne », voir si, comme le dit Platon, elle a une ouverture, s’y porter et sentir au dehors, ou une présence ou, au contraire, un néant. « L’univers, dit Whitehead, s’achemine ainsi, avec une lenteur que ne peuvent concevoir nos mesures du temps, vers de nouvelles conditions de création… » (RG, p. 159).
Pour opter entre les conceptions du divin, nous devons nous appuyer sur les acquis de la science moderne : nous vivons dans un monde en devenir où les entités individuelles ne sont pas isolables ; chacune d’elles « est un arrangement de tout l’univers » (RG, p. 101) ; et, en fin de compte, il n’y a qu’un seul type d’entités, « la créature se créant elle-même » (RG, p. 102). L’intuition religieuse saisit l’ordre de l’univers en tant que tout y est lié et qu’une libre créativité s’y manifeste.
- Le problème du mal
Surgit alors le problème majeur : comment la sagesse et la bonté de Dieu s’accommodent-elles du mal ? Le mal est-il impersonnel et comme inclus dans l’ordre du monde ? Dieu manque-t-il de puissance, à la différence du Dieu des Sémites ? Ou bien la voie historique du devenir, la pluralité des co-auteurs de l’univers, impliquent-elles comme une tragédie continuée à laquelle Dieu lui-même prend part et dont il souffre ?
La solution que donne Whitehead est optimiste, un peu à la manière du Timée (30 a-c), où Platon laisse entendre que Dieu fait prévaloir, autant que possible, l’ordre du Bien sur la nécessité.
3. Philosophie analytique et Philosophie de la nature

Russell et Whitehead, co-auteurs des Principia Mathematica, sont les pères fondateurs de la philosophie analytique. Pourtant, très tôt, un clivage est apparu entre la philosophie de Russell, méditation sur la logique et le langage, et la philosophie de Whitehead, réflexion sur la nature et le concept. Ces deux penseurs, après avoir composé ensemble une œuvre fondamentale de logique mathématique, deviennent les sources de deux courants philosophiques très différents – Bertrand Russell attachant au langage une importance majeure, et Alfred North Whitehead donnant pour tâche à la philosophie de restituer fidèlement les processus naturels. Pourquoi ?
Russell a plus confiance que Whitehead dans la capacité de la logique à rendre transparents les actes qui servent à constituer des édifices rationnels. Aussi montre-t-il de l’agacement lorsque Turing et Goedel, chacun de son côté, mettent en évidence que le système des Principia Mathematica n’est pas à l’abri du doute. La réaction de Whitehead est inverse : il lui paraît normal qu’une œuvre publiée entre 1910 et 1913 soit soumise à révision et à critique.
Comment comprendre, alors, qu’il construise une cosmologie ? Ne devrait-il pas, tout au contraire, employer son génie de logicien et de mathématicien à édifier des modèles qui s’ajusteraient provisoirement à la description de phénomènes particuliers ? C’est que Whitehead est mû par une espérance rationaliste qui lui fait croire que l’humanité n’est pas sans avoir accès au « logos entechnos (la raison industrieuse) » de Dieu, chère aux Pères cappadociens.
D’où tire-t-il sa foi dans la raison ? Des mathématiques et de la philosophie. De 1870 à 1940, il a été le témoin de changements profonds en mathématiques, en physique, en chimie et en biologie. On est passé, en soixante-dix ans, de la conception d’un univers éternel, uniforme et statique, à la vision d’un univers en expansion et en devenir. De même, l’hypothèse de l’évolution des espèces s’est trouvée confirmée. Enfin, l’histoire des sciences a été le champ d’un vaste processus d’unification de théories. Loin que cet immense mouvement des idées scientifiques le dissuade de chercher à retrouver, par concepts, modèles et expériences, le devenir de la nature, Whitehead se dote d’une méthode qui empêche la disparition (perishing) des idées et des êtres de conduire au subjectivisme et au nihilisme : il pense en réaliste dans un univers en devenir.
Process and Reality est la démonstration qu’une philosophie du devenir peut être, selon le vœu de Platon, un discours unique qui, partant de la naissance de l’univers, embrasse l’étude de l’homme à la lumière du divin. Dans Modes of Thought, après avoir dit que « la tâche d’une université est la création du futur », Whitehead définit ainsi la philosophie : « c’est une tentative résolue pour élargir la compréhension […] de chacune des notions qui entrent dans notre pensée habituelle » (MT, p. 171). Il prend pour exemple la mécanique newtonienne : l’homme de science et le philosophe ne se posent pas à son sujet les mêmes questions. Le premier tire les conséquences des principes de la théorie et étudie comment elles se réalisent dans l’univers. Le second s’interroge sur les idées qui servent de fondement à la théorie. La fonction majeure du philosophe est de démasquer ce que Whitehead nomme « The Fallacy of the Perfect Dictionary » (MT, p. 173), c’est-à-dire l’erreur qui consiste à croire qu’il existe un dictionnaire parfait contenant la définition exacte des idées applicables à l’expérience humaine. D’où, dans le travail philosophique, un côté critique.
En même temps, cet aspect ne suffit pas : philosopher, c’est s’engager « avec humilité dans un groupe voué à l’aventure, à la spéculation, à la recherche d’idées nouvelles ». De fait, au début des années 1940, une nouvelle forme du travail scientifique, non plus individuelle mais collective, prend corps. Le groupe devient un acteur décisif dans la recherche de la vérité.
En savoir plus :
- Retrouvez nos émissions Amphi 23
- Bertrand Saint-Sernin de l'Académie des sciences morales et politiques
