Les pérégrinations de Monsieur Thiers, voyageur collectionneur
Les voyages et les pays étrangers ont joué un grand rôle dans la vie d’Adolphe Thiers, journaliste, critique d’art, historien et homme d’État. En homme politique chargé de questions de politique étrangère, il a toujours eu à cœur de se documenter en profondeur, comme en témoignent les dossiers présents dans les archives de la bibliothèque Thiers. Sylvie Biet, conservateur en chef de la Bibliothèque de l’Institut et conservateur de la Bibliothèque Thiers présente un aspect peu connu de la personnalité et des actions de Thiers. Pourquoi tous ces voyages ? Quelles furent ses destinations ?
La Bibliothèque Thiers est située dans l’hôtel particulier Dosne-Thiers, place Saint-Georges dans le IXe arrondissement, à Paris. Actuellement, quelques vitrines évoquant les multiples pérégrinations de Monsieur Thiers sont présentées aux visiteurs.

Cette exposition est intitulée :
« Collections voyageuses et voyageur collectionneur : Les périples de Monsieur Thiers. »
Le savoir de Thiers (1797-1877) n’était pas purement livresque. Il tenait à se rendre sur place, à rencontrer les hommes politiques, à sonder l’opinion publique. Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, Hollande, Italie, Portugal, Suisse… quel pays de l’Europe de son temps n’a-t-il pas parcouru ?
Thiers voyagea certainement par goût, mais aussi pour trois raisons principales : des raisons utilitaires, l'histoire et la politique, et pour le plaisir, l'art pour l'art!
Les enquêtes historiques
Thiers allait sur place, à la recherche de témoignages historiques. D’abord, pour se documenter en vue de la rédaction de sa monumentale Histoire du Consulat et de l’Empire : ses scrupules d’historien, son souci d’exactitude l’incitèrent à parcourir tous les champs de bataille, à visiter toutes les villes et les localités qui servirent de cadre à l’épopée napoléonienne. Il poussait le détail jusqu’à interroger les habitants, à solliciter la mémoire de paysans qui furent témoins des batailles, qui virent passer la Grande Armée. Il s’émerveillait du souvenir que laissa Napoléon Ier dans la mémoire collective, y compris au sein de pays vaincus. Ce fut aussi pour se documenter qu’il séjourna plusieurs fois à Florence : il comptait, en effet, rédiger un ouvrage sur l’histoire de cette ville qui le passionnait.
Il a même été jusqu’à payer pendant quatorze années de suite un correspondant, Giuseppe Canestrini, chargé d’explorer pour lui les riches fonds d’archives et les bibliothèques florentines !

Derrière l’historien, l’homme d’Etat n’est jamais loin
Ses voyages eurent, aussi, des buts politiques. Point d’anonymat pour cet ancien président du Conseil, pour cet ex-ministre, pour ce député, et même pour ce proscrit en exil en 1852 (seule période où il se plaignit de voyager : il faut dire qu’on n’apprécie pas aussi bien les voyages forcés !). Dans chaque pays, de passage dans chaque capitale, il prenait grand soin de se faire recevoir par les souverains, les ministres, les personnalités en vue.
Il tissa ainsi tout un réseau de connaissances, de grandes familles francophiles, qui l’accueillirent à l’étranger ou qu’il reçut à Paris, dans son hôtel de la place Saint-Georges. Ce ne fut donc pas par hasard que Thiers fut choisi, en 1870, pour faire le tour des capitales d’Europe jusqu’en Russie dans l’espoir d’obtenir une intervention en faveur de la France vaincue. Mais en dépit de la bienveillance affichée par les souverains étrangers envers Monsieur Thiers, leur intervention se borna à un laisser-passer pour que le parlementaire pût retraverser sans encombre les lignes prussiennes.

Grand amateur d'art italien et pionnier en matière d'art asiatique
Cependant ce ne furent pas seulement des raisons utilitaires qui poussèrent Adolphe Thiers à voyager, mais aussi le plaisir de la découverte et des aspirations esthétiques. Il ne fut pas un musée, pas un monument qu’il ne visitât au cours de ses voyages. En ce sens, l’Italie fut sa destination favorite. Florence, bien sûr, mais aussi Rome, Naples, Pompéi : dans ses lettres à sa famille, il s’étendit longuement sur ses émotions artistiques et les impressions fortes recueillies lors de ses pérégrinations. Puisque ses occupations politiques ne lui permirent pas de voyager aussi souvent qu’il le voulait, il fit venir à lui un peu de l’âme de ces pays, incarnée dans les chefs-d’œuvres qu’il collectionnait.
C’est ainsi qu’il chargea Ingres à Rome, mais aussi Joseph Tourny et le sculpteur Maniglier, de la mission de faire venir des œuvres d’art et de réaliser des copies dans de nombreux musées d’Europe.
La Bibliothèque Thiers conservent beaucoup de lettres et de factures relatives à ces commandes. Si la plupart des tableaux et des sculptures de la collection Thiers sont désormais au Louvre, on peut encore admirer la qualité de certaines reproductions de peintures italiennes et espagnoles sur les murs de la Fondation Dosne-Thiers.
L’intérêt de Thiers ne se cantonna pas, cependant, à l’Europe : à une époque peu ouverte à l’art des autres continents, il fit figure de pionnier, voire même de « spécialiste », en matière d’art asiatique.
Dès 1841, on le voit, dans une de ses lettres à Mme Dosne, sa belle-mère, discuter d’art chinois. Entre 1851 et 1852, Thiers correspondit assidument avec Stanislas Julien, un maître des études chinoises de son temps. Mais ce fut surtout le voyageur Charles Marchal, de Lunéville, qui le fournit en documentation sur la Chine et la Mongolie : « Théorie de la langue chinoise en une leçon », albums, gouaches et dessins, originaux ou copies, dont un plan de Pékin.
Dans le catalogue de sa bibliothèque, on ne recense pas moins d’une centaine de livres « chinois » (écrits en chinois, ou traitant de la Chine).
Thiers achetait, aussi, des objets d’art et des vases asiatiques en vente publique. On peut admirer quelques-unes de ces pièces dans son cabinet au premier étage, ou sur la cheminée de la salle de lecture.

Décorations internationales et témoignages de reconnaissance envers le « Libérateur du territoire »
La reconnaissance de Monsieur Thiers à l’étranger s'accentua, bien sûr, après son accession à la présidence de la République française, qui marqua le couronnement de sa réputation internationale. Deux ensembles remarquables sont là pour en témoigner :
- les décorations internationales :
dès 1836, Adolphe Thiers avait reçu le cordon de l’ordre de Charles III d’Espagne, qu’il arborait fièrement lors d’un dîner officiel à Madrid en septembre 1845.
Peu après, ce fut au tour de son épouse Elise d’être honorée de la Real Orden de Damas nobles de la Reina Maria Luisa (ordre militaire espagnol réservé aux femmes). Devenu chef d’Etat, Thiers fut décoré de l’ordre prestigieux de la Toison d’or espagnole, ainsi que de l’ordre militaire de la Tour et de l’Epée de valeur, loyauté et mérite, décerné par le roi du Portugal.
- les témoignages de reconnaissance envers le « Libérateur du territoire »: ce ne fut, certes, pas comme le bourreau de la Commune que ses contemporains perçurent Monsieur Thiers, mais comme l’homme providentiel qui réussit à obtenir l’évacuation du territoire français par les troupes d’occupation prussienne en un temps record et le redressement du pays. Des villes, des départements envoyèrent en masse des livres, des médailles, des diplômes de toute la France, mais aussi de l’étranger, émanant de Français expatriés comme ces habitants de Philadelphie qui félicitèrent Thiers d’instaurer le régime républicain, ou comme ces Français du Pérou qui lui firent parvenir un magnifique album de photographies à la reliure somptueuse. Parfois, ce furent les ressortissants du pays eux-mêmes, comme ces jeunes Roumains qui signaient d’enthousiasme un livre d’or…
En conclusion, les rapports d’Adolphe Thiers avec l’étranger mériteraient plus qu’une exposition réduite, ils nécessiteraient une étude à part entière, tant ils furent nombreux et féconds.
Les fonds conservés à la bibliothèque Thiers pourraient servir de base à ces recherches, car cet aspect de la personnalité et des actions de Monsieur Thiers n’a été que partiellement exploré.
Quelques citations en guise de bibliographie :
Charles Blanc : Le Cabinet de Monsieur Thiers.
« Le grand art italien y occupait de beaucoup la première place, mais l’universalité était le caractère le plus marquant de ce petit musée où Thiers avait fait bon accueil au beau de tous les pays : le germanique, l’espagnol, le français, le batave, l’indien, le grec, le chinois. »
Gabriel Maugain : Thiers et son histoire de la République de Florence. L’auteur cite un discours de Thiers à l’Assemblée :
« Messieurs, disait-il, sans faire étalage de mon affection pour l’Italie, je puis dire qu’après la France, elle est la contrée que j’ai le plus visitée, le plus aimée, et j’ajouterai que c’était son histoire que j’écrivais lorsque je m’en suis détourné pour écrire l’histoire de mon pays »
C’est dans Correspondances : 1841-1865, M. Thiers à Mme Thiers et à Mme Dosne, ouvrage édité à Paris en 1904, qu’on trouve le plus de témoignages vivants et anecdotiques sur les voyages de la famille Dosne-Thiers.
M. Thiers à Mme Dosne, Berlin, 17 août 1841 :
« Nous sommes encore à Berlin, bien que nous ayons tout vu ; mais une visite chez le roi de Prusse nous retiendra encore deux jours. J’espère que nous pourrons partir vendredi et aller coucher à Dresde. Nous passerons deux ou trois jours dans cette dernière ville ; après quoi nous partirons pour Prague, où nous resterons encore un jour ou deux. De là, comme il était convenu, un jour pour aller à Iglau, un pour aller à Brünn, un pour voir Austerlitz, et le lendemain, nous arriverons à Vienne. »
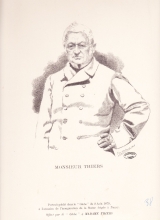
M. Thiers à Mme Dosne, Dresde, 21 août 1841 :
« Je viens de visiter le Musée, le Palais japonais et enfin le fameux champ de bataille de Dresde. Ce dernier objet, le principal pour moi, a été d’un très grand intérêt. […] Je vous ai fort regrettée au Palais japonais. C’est là que vous auriez vu toutes mes théories, que vous combattez, complètement justifiées. Je persiste donc, comme les gens à système, dans ma façon de penser sur l’art chinois. On possède ici des vases originaux, ce qui est beaucoup mieux qu’à La Haye où l’on n’a que des figures moulées. Je n’ai vu nulle part de tels vases, ni si beaux, ni en si grande quantité ; quelques-uns sont de vrais chefs-d’œuvre, d’autant plus précieux pour moi, qu’il y en a sur lesquels on trouve des inscriptions déchiffrées et portant leur date. J’ai donc fait une riche récolte de notes intéressantes sur l’histoire de l’art, dont je poursuis toujours l’idée sans m’en vanter. »

Dresde, le 22 août 1841 :
« … J’ai encore deux jours à employer ici, car la galerie des tableaux est importante et le pays rempli de traditions que Napoléon y a laissées. Il a passé ici plusieurs mois, pendant la campagne de 1813 ; j’ai trouvé de vieux militaires, restés fidèles au souvenir de notre armée dans laquelle ils avaient servi, et qui ont la mémoire pleine des détails les plus importants et les plus curieux. […] J’ai vu le lieu où a été tué Moreau. Il avait eu les deux jambes fracassées. On les lui amputa, on les jeta dans un fossé recouvert avec des planches […] Un Saxon m’a montré la chaussure de Moreau qu’il avait gardée. »

Vienne, le 9 septembre 1841 :
« … Au lever du soleil, j’ai aperçu les clochers de Brünn et le lointain d’Austerlitz. J’ai pris une voiture du pays et j’ai passé dix heures sur le champ de bataille que je désirais tant connaître. Il n’y a pas un coin que je n’ai vu et que je ne sache par cœur. On est loin à Austerlitz de notre Europe, car mon guide allemand n’arrivait plus à se faire entendre ; le peuple est slave et ne parle pas l’allemand. Cependant nous avons rencontré un paysan, sachant les deux langues, qui m’a aidé à constater les vrais noms des villages, défigurés souvent par nos rapports français. »
En 1845, M. Thiers voyage en Espagne.
Madrid, 10 septembre 1845 :
« … Hier, le dîner de M. de Miraflorès a été fort brillant, et l’on s’y est montré très aimable pour moi. Tous les ministres y étaient, les autorités militaires, les grands d’Espagne présents à Madrid […]. J’ai fait la politesse de mettre le cordon de Charles III, et chacun portait ses décorations. Au milieu du repas, M. de Miraflorès a proposé un toast « en souvenir des services rendus par M. Thiers à la cause espagnole » ».
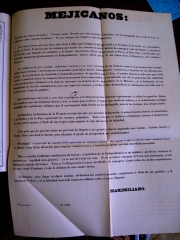
Madrid, 12 septembre 1845 :
« J’ai assisté aujourd’hui à une course de taureaux. C’est un spectacle étrange, horrible et, à certains moments, superbe. Un pareil spectacle n’en est pas moins indigne d’une nation civilisée. Je l’interdirais si je gouvernais ce pays. Mais on m’affirme que c’est impossible, et que ce serait s’exposer à une révolution. »
Tout au long de ses lettres espagnoles, Thiers fait des descriptions pittoresques des auberges où l’on doit apporter son déjeuner, voire même son lit, des routes à peine carrossables, des villes en ruine, des histoires de bandits.
Témoin cette description de la route qui mène à Tolède, écrite à Aranjuez, 13 septembre 1845 :
« Rien ne peut donner une idée des routes qui ne sont pas routes de poste, en Espagne. Celle de Tolède est de ce nombre, et on y avait placé des relais extraordinaires exprès pour nous. De plus, on nous avait fait escorter. Dans une moitié du trajet, on passe en plein champ, exactement comme dans la Russie méridionale. Quand un passage est usé, on en prend un autre. Point d’êtres vivants, point de cultures, excepté au bord du Tage, dans ce qu’on appelle la huerta de Tolède. »
Et encore, dans sa lettre postée de Baylen le 18 septembre 1845 :
« Quoique j’aie beaucoup souffert de la malpropreté, de la mauvaise nourriture, de la chaleur et de la dureté des routes, je suis charmé d’avoir vu l’Espagne. »
Thiers en exil souffre de l’éloignement de sa famille, de l’inaction et de l’ennui.
Londres, 9 mars 1852 :
« Vous verrez, mes chères amies, ce que c’est que d’être dans un pays où on ne s’intéresse à rien, quelque bon que soit l’accueil que vous y fassent de braves gens. C’est absolument comme d’être à la campagne, quand on n’y est pas chez soi. Vous l’avez éprouvé. Eh bien c’est encore pis. J’ai tort de vous accabler de toutes ces réflexions ; mais je ne puis résister au besoin de vous les dire. Je m’arrête, car c’est bien assez. »
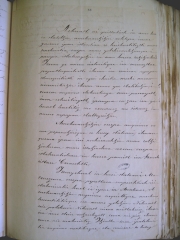
Bâle, 25 avril 1852 :
« Voilà bien de la politique, plus que je n’en ai fait depuis bien longtemps, et vous savez que si je voyage à cause d’elle, je ne voyage pas pour elle. C’est l’attrait de mes études préférées qui me soutient, me pousse, me mène en tous lieux, car les livres ne sont que la moitié des témoins qu’il faut interroger pour comprendre le passé du monde. A mesure que je vois des choses nouvelles, je sens se réveiller en moi la confiance dans la vie, je redeviens jeune, je rêve encore de l’avenir. Il faut donc excuser, même lorsqu’il m’éloigne de vous, ce besoin de voir et d’apprendre, besoin qui est ma raison d’être. »
Milan, 27 avril 1852 :
« Le jour où tous mes sens seront près de s’éteindre, on n’aura, pour me rendre le goût de vivre, qu’à me transporter en Italie. »

Canal Académie vous invite à découvrir les autres émissions d'Anne Jouffroy