
La vie et la grève des ouvriers en 36, une expérience de la philosophe Simone Weil (4/4)
Simone Weil a voulu se faire ouvrière, en 1936. Elle a raconté par écrit son expérience en usine, une vie pénible, physiquement et moralement. Lara Guirao, comédienne française qui interpréte au cinéma le personnage de Simone Weil, nous fait lecture des passages qui l’ont le plus touchée.
Cette lecture a été enregistrée en février 2009 alors que le film sur Simone Weil est en finition de montage et sortira prochainement sur les écrans français. La réalisatrice en est l'italienne Emanuela Piovano.
"Commander ne rend pas facile de se mettre à la place de ceux qui obéissent. Rien ne paralyse plus la pensée que le sentiment d’infériorité nécessairement imposé par les atteintes quotidiennes de la pauvreté, de la subordination, de la dépendance. La première chose pour eux, c’est d’arriver à retrouver ou à conserver selon le cas le sentiment de leur dignité. Je ne sais que trop combien il est difficile dans une pareille situation de conserver ce sentiment, combien tout appui moral peut être alors précieux.
J’espérais de tout mon cœur pouvoir par ma collaboration à votre journal apporter un petit peu d’un tel appui aux ouvriers de Rosières…
Pour les malheureux, leur infériorité sociale est infiniment plus lourde à porter du fait qu’ils la trouvent présentée partout comme quelque chose qui va de soi…
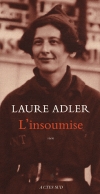
C’est ma première journée dans cette usine ; elle m’avait paru accueillante la veille, après toute un journée passée à arpenter les rues, à présenter des certificats inutiles, enfin ce bureau d’embauche avait bien voulu de moi ; comment se défendre au premier instant d’un sentiment de reconnaissance…
Me voici sur une machine. Compter 50 pièces, les placer une à une sur la machine, d’un côté pas de l’autre, manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, en mettre une autre, encore une autre, compter encore, je ne vais pas assez vite, la fatigue se fait déjà sentir, il faut forcer, empêcher qu’un instant d’arrêt ne sépare un mouvement du mouvement suivant, plus vite, encore plus vite. Allons bon, voilà une pièce que j’ai mise du mauvais côté -qui sait si c’est la première, il faut faire attention, cette pièce est bien placée, celle-là aussi, combien est-ce que j’en ai fait ces 10 dernières minutes ? Je ne vais pas assez vite, je force encore, peu à peu la monotonie de la tache m’entraine à rêver, pendant quelques instants je pense à bien des choses, réveil brusque, combien est-ce que j’en ai fait ? Ca ne doit pas être assez, faut pas rêver, forcer encore, si seulement je savais combien il faut en faire, je regarde autour de moi, personne ne lève la tête, jamais, personne ne sourit, personne ne dit un mot, comme on est seul ! je fais 400 pièces à l’heure, savoir si c’est assez, pourvu que je tienne à cette cadence au moins ; la sonnerie de midi enfin, tout le monde se précipite à la pendule de pointage au vestiaire hors de l’usine, il faut aller manger, j’ai encore un peu d’argent heureusement, mais il faut faire attention, qui sait si on va me garder ici. Je ne chômerai pas encore des jours et des jours. Il faut aller dans un de ces restaurants sordides qui entourent les usines, ils sont chers d’ailleurs, certains plats sont assez tentants, mais ce sont d’autres qu’il faut choisir, les meilleurs marché, manger coûte un effort encore. Ce repas n’est pas une détente. Quelle heure est-il ? Il reste quelques moments pour flâner mais sans s’écarter trop. Pointer une minute en retard, c’est travailler une heure sans salaire… l’heure avance, il faut rentrer. Voici ma machine, voici mes pièces, il faut recommencer, aller vite, je me sens défaillir de fatigue et d’écoeurement, quelle heure est-il ? Encore deux heures avant la sortie, comment est-ce que je vais tenir ? Voilà que le contremaître s’approche : « combien en faites-vous ? » « Quatre cents à l’heure » « il en faut huit cents, sans quoi je ne vous garderai pas, si à partir de demain vous en faites huit cents, je consentirai peut-être à vous garder». Il parle sans élever la voix, pourquoi élèverait-il la voix quand d’un mot il peut provoquer tant d’angoisses, que répondre, « je tâcherai ». Forcer, forcer encore, vaincre à chaque seconde ce dégoût, cet écoeurement qui paralyse, plus vite, il s’agit de doubler la cadence. Combien en ai-je fait ? Au bout d’une heure six cents, plus vite. Combien au bout de cette dernière heure six cent cinquante. La sonnerie, pointer, s’habiller, sortir de l’usine, le corps vidé de toute énergie vitale, l’esprit vide de pensées, le cœur submergé de dégoût, de rage muette, et par-dessus tout cela d’un sentiment d’impuissance et de soumission car le seul espoir pour le lendemain c’est qu’on veuille bien me laisser passer encore une pareille journée…
Il s’agit après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d’oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours, indépendants des revendications.
Cette grève est en elle-même une joie, une joie pure, une joie sans mélange, oui une joie.

En savoir plus :
Consultez le site officiel de la comédienne Lara Guirao
Ecoutez les autres émissions consacrées à Simone Weil :
Simone Weil : sa vie bientôt portée à l’écran (1/4)
Vivre dans l’ombre de la philosophe Simone Weil
Simone Weil : moments d’une vie intense (2/4)
Parcours et oeuvres de la philosophe Simone Weil (3/4)
