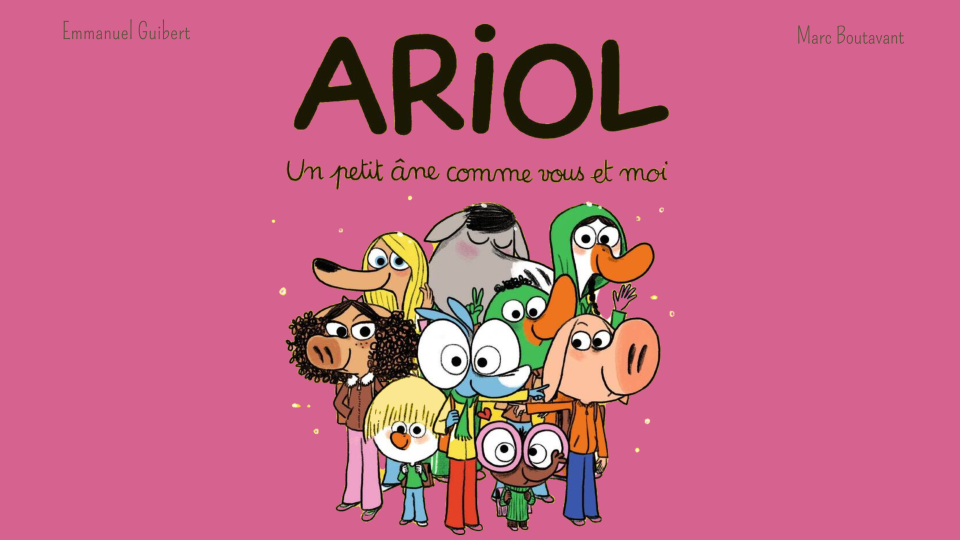Une journée à l’Académie des beaux-arts avec François Chaslin
François Chaslin, critique d’architecture donne sa vision de l’architecture aujourd’hui dans une communication qu’il a prononcée le 28 novembre 2012 dans le cadre d’une journée d’ouverture et de débats de l’Académie à différents acteurs du monde de l’art : « L’architecture, entre coups d’éclats et éclatement ». Que reste-t-il du métier d’architecte ? Vers quoi le portent les valeurs qui dominent la période que nous vivons, principalement celles du libéralisme
économique et de la mondialisation ?
Texte de François Chaslin
L'architecture, éclats et émiettement
Vous vouliez nous parler d'un danger qui paraît menacer l'architecture. Oui, celui de son éclatement, de son émiettement en de nombreuses professions. Je n'en parlerai pas sur le mode de la déploration, car il est fatal et s'inscrit dans la marche générale du monde. J'essaierai de montrer ce qui peut rester à ce métier qui corresponde à ses ambitions traditionnelles. Et ce vers quoi le portent les valeurs qui dominent la période que nous vivons, principalement celles du libéralisme économique et de la mondialisation.
Qu'on m'entende bien : il n'y a jamais eu d'époque où l'architecture aurait constitué une seule profession, une sorte de farandole comme dans ce monôme des élèves de l'école des Beaux-Arts
sur une gravure d'Alexis Lemaître (L'École des Beaux-Arts, 1889). Il n'y a jamais eu d'époque où sa doctrine, ses principes moteurs, ses rêves, ses codes ou son esthétique auraient été unanimes. Ce
que l'on sait de la Renaissance ou de l'âge classique révèle déjà la diversité des métiers et des statuts, leurs frontières mouvantes. Au milieu du Quattrocento, Alberti précisait "à qui au juste" il réservait le nom d'architecte : à "celui qui, avec une raison et une règle merveilleuse et précise, sait premièrement diviser les choses avec son esprit et son intelligence, et secondement comment assembler avec justesse, au cours du travail de construction, tous ces matériaux qui (etc., etc.)."
Diviser les choses avec son esprit, et assembler tous ces matériaux. Un siècle plus tard, Philibert de l'Orme, que l'on tenait pour le "premier des architectes français", ne consentait à la plupart de ses confrères que le titre de maîtres maçons. Cette discipline, qui s'est constituée en profession libérale au cours du dix-neuvième siècle, elle conserve d’elle-même une idée sans cesse plus archaïque.
Les petits praticiens de banlieue ou de province, ceux dont les noms se lisent sur des plaques émaillées aux façades des pavillons de meulière, n'ont eu, bien sûr, que peu à voir avec leurs contemporains de meilleure notoriété. Ces notables qu'Édouard Pourchet avait photographiés, pour son album de 1894 Nos Architectes, parmi leurs meubles et face à une bibliothèque de traités, reliés de cuir (ici Honoré Daumet, prix de Rome 1855, membre de l'Institut, reconstructeur de Chantilly et restaurateur du théâtre antique d'Orange). Longtemps pourtant, et même chez les professionnels les plus établis, la dichotomie, la schizophrénie diraient nos psychanalystes, ont été de règle. Qu'on se souvienne de cette page des Mémoires d'un architecte dans laquelle Fernand Pouillon évoquait en 1968 une conversation entre deux de ses confrères : "- Que fais-tu? - Du sordide. Et toi? - Moi aussi. (...) Les mêmes architectes, précisait Pouillon, mignotent amoureusement un projet d'église pour Santa Fe, ou une salle de concert destinée à Honolulu. Et la conversation prend un ton différent : - Je construis en éléments sur coffrages paraboloïdes hyperboliques; d'ailleurs, tu verras dans le prochain numéro d'Architecture d'Aujourd'hui, il y aura des photos et un article de Vago ou de Bloch sur les formes étonnantes de mes structures."
La figure de l'architecte mimant le prince a été superbement incarnée dans les années soixante encore par le constructeur de grands ensembles Émile Aillaud, l'auteur de la Grande Borne. Y compris dans son accoutrement : blouse, lavallière, des cols extraordinaires, des manchettes pleines de broderies, de lourdes chaînes en or. Il s'agit d'une profession tiraillée entre une aspiration au modèle de l'artiste et son immersion dans un univers où d'autres spécialistes, les
ingénieurs notamment puis une multitude de savoir-faire au fur et à mesure que s'accroissait la division technique du travail, n'ont cessé de lui tailler des croupières. Face à cette nouvelle réalité, certains en appelaient à une "création collective" comme l'architecte Joseph Belmont dans un ouvrage de 1970. Raymonde Moulin a fait en 1973 la sociologie de ce métier, au moment où il connaissait un de ses grands basculements. Elle notait un désenchantement général chez des
praticiens travaillés par le mythe du démiurge (du "chef d'orchestre" disait-on), dans un univers où l'expertise était "atomisée" et les prestations de l'architecte devenues fragmentaires. C’était il y a
quarante ans. Depuis, le mouvement s'est bien sûr formidablement accéléré. Plus de chef d'orchestre, plus vraiment de compositeur (on parlait couramment de "composition" urbaine, comme dans cet ouvrage de Pierre Riboulet, Onze leçons sur la composition urbaine, 1998), éventuellement des orchestrateurs, à condition qu'ils tolèrent les couacs et les dissonances.
Les choses se sont complexifiées à un tel point que l'analyse de la profession, du métier, ou plutôt des métiers d'architecte (et notamment en termes sociologiques) est devenue un genre universitaire et éditorial en soi (quelques exemples : Bernard Haumont, Figures salariales et socialisation de l'architecture, 1985; Florent Champy, Les architectes et la commande publique, 1998; Louis Callebat, Histoire de l'architecte, 1998; Les Cahiers de la recherche architecturale, numéro Métiers, 1999; Guy Tapie, Les architectes : mutations d'une profession, 2000; Florent Champy, Sociologie de l'architecture, 2001; Michel Huet, L'architecte maitre d'oeuvre, 2001; André Ducret, Claude Grin, Paul Marti, Ola Söderström, Architecte en Suisse, enquête sur une profession en chantier, 2003; Olivier Chadoin, Etre architecte, les vertus de l'indétermination, 2007; Thérèse Evette, Les métiers de l’architecture en Ile-de-France, 2012.)
Voici une gravure célèbre de l'architecte postmoderne Aldo Rossi : Dieses ist lange her / Ora, questo è perduto, "Maintenant, tout cela est perdu." Une allégorie de la discipline écroulée. 1975 déjà. Une déploration, vous disais-je.
Ce que je veux souligner, c'est qu’il s'est opéré une redéfinition de la place de l'architecte dans les processus de construction, une redéfinition qui tend à minorer son rôle, à l’encadrer d’une part, à l'accabler de normes estime-t-il (avec quelques raisons), à le contraindre au partage des compétences d’autre part. Et qui le renvoie qu'il le veuille ou non au statut d'artiste, d’artiste plutôt que de technicien, d’artiste plutôt que d’ordonnateur du monde. Artiste glorieux dans le cas de certaines vedettes, plus dérisoire et surtout chagrin dans beaucoup d'autres situations.
Ordonnateur du monde? Bien sûr. Souvenons-nous de l'introduction de Claude-Nicolas Ledoux, à son ouvrage de 1804 : L'Architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation. "L'Architecture est semblable aux astres bienfaisants qui éclairent le monde. (...) Quel mortel à cet aspect imposant, ne sent pas toute sa petitesse et ne se prosterne pas devant
l'Architecte rival du Créateur?"
Cette activité est de bric et de broc. Il arrive à ses positions de sonner creux, comme les armures du film de Bresson, Lancelot du lac, qui émettaient, vous vous en souvenez, un bruit de casseroles. Ou comme l'architecte de la gravure baroque l’Habit d'architecte (de la série des Costumes grotesques et métiers de Nicolas de l'Armessin), qui m’évoque un colporteur en tuyaux de poêle Je vais tenter de vous présenter quelques exemples de son évolution, et in fine de préciser, en quelques mots, certaines dimensions doctrinales, techniques, sociales et artistiques qui, pour les années que nous vivons en tout cas, ouvrent néanmoins des perspectives à la création architecturale.
J'aurais aimé illustrer cet exposé simplement par des portraits d'architectes, tant ils sont révélateurs de leur statut. Voici un jeune pensionnaire à la villa Médicis, Charles Garnier, peint en1848 par son ami Gustave Boulanger; le voici célèbre dix ans plus tard dans un tableau de Paul Baudry, avec les instruments traditionnels de la corporation, équerre et rouleaux de plans; puis photographié par Nadar. Voici un architecte statufié, en buste : Félix Duban par Cavelier (1872), déposé au bas de l'escalier du bâtiment dans lequel nous nous trouvons, près des portemanteaux.
Toujours, le visage de l'architecte a été redessiné par lui : lavallière, barbe, canne à pommeau, canotier à sous-face blanche d'Auguste Perret. Nœud papillon et lunettes du Corbusier, qu'on trouve en objet perdu "à réaction poétique" sur cette nature morte photographique de René Burri (1960), sur tant de portraits, notamment celui d'André Villers (1955) dont en 1995 la Suisse en avait fait son billet de dix francs, et qui sont maintenant vendues sous son nom par les lunettiers Bonnet. Cuir noir et bottes "santiag" de Daniel Libeskind.
Voici une figure connue. Oui, celle d'un architecte d'avant-garde des années soixante, Claude Parent et ses favoris. Le même, devenu académicien et récemment coulé dans le bronze. Voici un "couillu", dans une certaine tradition Beaux-Arts : Pierre Parat vu par son ami le sculpteur Philolaos (l'objet accueille les visiteurs dans le hall de son immeuble). Voici l'une des premières vedettes mondialisées de l'architecture et parmi les initiateurs du genre médiatique : Philip Johnson en couverture d'un numéro de Time Magazine de janvier 1979. Johnson, caustique, cynique, dont la plus grande contribution à la pensée contemporaine aura été son célèbre "I am a whore, je suis une pute". Idée moderne, d’ailleurs répercutée à l'envie sur Internet. Faites l’expérience, tapez les trois mots Philip, Johnson et whore sur Google, vous obtiendrez 233 000 réponses en 0,37 secondes.
Voici Philippe Starck, le designer qui construit d'abord sa propre image (poussée à la limite du pitre) puis celle des marques qui l’emploient. D’abord la sienne, car sa propre image sert celle des
marques et des produits qu’il redessine. Voici deux stars contemporaines : Zaha Hadid en somptueux froufrou de diva et Jean Nouvel campé en contreplongée comme sur l’affiche d’un film
américain. Voici Rudy Ricciotti ou la version rock star, l'architecte en animal sexué et parfois destroy. Star, l’expression est tout à fait nouvelle : le Cavalier Bernin était une personnalité ²adulée, courtisée et parfois capricieuse, mais pas une star. La notion est moderne, les codes en sont différents.
Voici un architecte au travail à l'époque de l'Art nouveau : le Belge Henry van de Velde, représenté à sa table à dessin par Theo van Rysselberghe : un rapin, quelque chose de bohème. Et le même
quelques années plus tard, vers 1923, avec té et équerres encore : notez la modeste blouse blanche de l'artisan ou du contremaître. Voici Le Corbusier avec son simple carnet de croquis à l'usine Duval
de Saint-Dié, vers 1950. Et Norman Foster travaillant comme un ministre dans son propre avion (en général, d'ailleurs, il préfère le piloter). L'architecte célèbre est mondialisé, sans cesse en
déplacement. Rem Koolhaas, dans son livre de 1995 S,M,L,XL, publiait sur une double page le graphique de ses voyages et de ses nuits d'hôtel. Et notre ami Roger Taillibert : 86 ans et 40 000 kilomètres par an (ai-je cru entendre), étirés entre les Émirats et l'Amérique du Nord.
Voici maintenant des vues d’agences. Corbu dans son atelier de la rue de Sèvres, photographié en mars 1950 par Robert Doisneau puis par René Burri en 1959. Il n’y passait que l'après-midi car le matin il peignait, chez lui, rue Nungesser-et-Coli (Doisneau, 1945, et Burri, 1960). Foster encore une fois, sur la mezzanine qui domine l'une des plus grosses agences du monde contemporain, la sienne. Le patron, donc, et à l’étage inférieur un paysage humain que l’on dirait inspiré de Jacques Tati : la nappe monotone de ses collaborateurs rivés à un ordinateur (il aurait eu jusqu'à 1 500 salariés, il en compterait encore 500 à 600). A quoi rêvent-ils, derrière leur écran?
L'architecture est un entrelacs de compétences. D’abord au sein même de chaque agence, comme entendait l'exprimer un autre graphique de Koolhaas dans l’ouvrage dont nous parlions. Mais aussi au sein des groupes de maîtrise d'ouvrage. Voici par exemple la composition des équipes exigée il y a quelques semaines dans un avis de concours pour une simple piscine : spécialistes en fluides et thermique, en structures, économie de la construction, paysage, acoustique, scénographie ou architecture d'intérieur, développement durable, voiries et réseaux. Ceci, est-il précisé, "dès l'acte de candidature". C'est un générique de film. Passons. Et je ne parle pas des PPP, les partenariats public-privé dans lequel l'architecte n'est plus qu'un partenaire fragile au sein d'une équipe organisée et totalement dominée par une des entreprises majors du bâtiment. Les grosses agences d'architecture sont divisées en véritables départements avec toute une hiérarchie de chefs de projets. Comme dans l'industrie, leur gestion, leur pilotage nécessite le concours de compétences spéciales, celles des process managers.
Et l'urbanisme? L'urbanisme, sous l'effet des normes, du marché immobilier et de la concentration des investissements en quelques groupes de promotion, est devenu répétitif et stéréotypé (un peu
comme il avait pu l'être en d’autres temps : dans les villes haussmanniennes, dans la reconstruction des villes détruites ou, sur des bases toutes différentes, pendant les Trente Glorieuses). On pourra
s'en consoler en jugeant qu'il a atteint un standard, un moment d'équilibre. Toujours est-il que la hauteur des immeubles, leur épaisseur, leur silhouette, le rythme des cages d'escalier, le type des balcons, la relation aux espaces verts se répètent d'une opération à l'autre, avec des variations dans l'écriture des façades lorsque les îlots sont découpés en quelques lots, confiés à autant d'architectes. Ce n’est plus que de la frime, de l’ornement. Les paysagistes, omniprésents dès que
l'opération prétend à un certain standing (comme dans le Trapèze de Billancourt), multiplient les interventions, déploient un nouvel imaginaire urbain à connotations bucoliques et sèment leurs touffes de graminées dans l'univers plus minéral des architectes (ceci pour le contester, bien sûr).
C'était pour la déploration mais, dans le même temps, l'urbanisme des villes européennes a su développer d'extrêmes compétences dans les domaines les plus variés, historiques, politiques, économiques, circulatoires et de sécurité aussi bien que patrimoniales, festives, botaniques, acoustiques ou d'ambiance lumineuse : autant d'ingénieries spécifiques qu'il s'agit de croiser entre elles.
Vous parliez d'une redéfinition du statut de l'architecte et de sa place relative. Il est indéniable que l'époque est demandeuse d'art, d'architecture en tant qu'art, que grand art, que performance
même. Cela culmine, si l'on peut dire, dans les commandes liées au luxe, notamment les fameux flagship stores, les vaisseaux-amiral des compagnies de couture, qui emploient les mêmes concepteurs que les musées : une très short list. Arpentant le quartier de Ginza ou l'avenue Omotesando à Tokyo, on découvre une collection d’édifices à la gloire de Dior, Hermès, Vuitton ou du maroquinier Tods. Ils sont signés par Tadao Ando, Shigeru Ban, Renzo Piano, Kengo Kuma,Kazuyo Sejima, Fumihiko Maki, Mario Botta, Toyo Ito. Ce sont les mêmes signatures que se disputent les magnats du luxe et de l’art, Bernard Arnaud et François Pinault et, après eux, les musées du monde entier et, après eux encore, les élus locaux soucieux de marketing et désireux de s'adjoindre une signature prestigieuse pour des projets d'urbanisme, même si c'est sans aucune relation avec ce qui a fondé leur réputation initiale.

Les Bâlois Herzog et de Meuron, Pritzker Prize 2001, un exemple parmi d’autres : ici pour Prada, sur Omotesando. Dans leur pays, ils sont les architectes des empires pharmaceutiques Roche et Novartis, ailleurs des chais de château Pétrus, du fabricant de meubles Vitra, de la Tate Modern de Londres, de la fondation Caixa pour sa succursale madrilène du paseo del Prado, du De-Young Museum de San Francisco, du Walker Art Center de Minneapolis pour sa nouvelle aile, de la rénovation du musée Unterlinden de Colmar, de la Chine pour le stade olympique de Pékin, de Hambourg pour la nouvelle philharmonie de l’Elbe, de la Ville de Paris à la recherche d'un gratte-ciel qui convainque une opinion réticente à l’égard des tours, et finalement de la municipalité lyonnaise pour le plan d'urbanisme de la seconde phase de l'aménagement de la presqu'île, la Confluence.
Le vedettariat est international. Oui, planétaire et omnivore. Les lauréats du Pritzker Prize américain sont sollicités aux quatre coins du monde. Ici invités à l’Élysée par Nicolas Sarkozy en septembre 1997, en marge du lancement du Grand Paris. Il existe un marché des architectes célèbres comme il existe un mercato des footballeurs. La signature, la "marque" des architectes stars est survalorisée. Elles permettent, comme un label, de vendre toutes sortes de produits, des produits dérivés en un sens, exactement comme la mouche des couteaux Laguiole lorsqu'on l'applique à des fourchettes ou à des stylos, à de la maroquinerie et jusqu'à des pantoufles. Eux, comme Aldo Rossi dont voici divers "produits", ce seront des théières pour Alessi, des dessins, des architectures évidemment, des plans d’aménagement urbain ou des ouvrages de théorie. "On me demande d'être une marque" déclarait Christian de Portzamparc au journal Libération dans un numéro de l'été 2006.
Quant aux autres, architectes ordinaires, leur imaginaire fait un grand écart, quidams dans leurs petites autos, contraints de rouler à cinquante à l'heure face à des pilotes de formule un auxquels
on permet toutes les embardées. Tiraillés entre mirage et réalité, avec partout, dans le monde entier au même moment, les mêmes modèles et les mêmes tentations esthétiques.
Et puis les architectes ont senti la maîtrise du territoire leur filer entre les doigts. Ils ont compris que la ville n’était pas seulement une machine fonctionnelle comme le pensaient les modernes, et comme en témoigne ce magnifique projet de Le Corbusier pour l'urbanisation d'Hellocourt (1935), ni une œuvre d’art comme le déclaraient les postmodernes (l’héritage du passé, la concrétion des imaginaires), ces postmodernes qui révéraient le plan de Rome de Giovanni Battista Nolli (1748), mais aussi une réalité indomptable, une substance comme l’écrivit Koolhaas, une donnée objective, un processus en mouvement qui recouvre le monde, le nouveau monde en tout cas (ici la ville chinoise de Chongqing, 34 millions d'habitants peut-être). Quant à l’ancien monde, le nôtre, ses paysages et ses quartiers sont inscrits sur les listes de l’Unesco, villages fleuris, petites cités de caractère, la vie rêvée par Amélie Poulain. Nous sommes condamnés à se maintenir en l’état. Ailleurs se construisent des cités énormes, des forêts de gratte-ciel. Ailleurs se répand la ville générique, de Lagos à Vancouver, la ville comme genre, quasiment sans identité propre, bulldozer indifférent aux paysages et à l’histoire qu’elle recouvre et lamine. Et même le sentiment d'une Europe muséifiée est une illusion : depuis l'espace, comme sur cette photographie nocturne de nos régions faite par la Nasa, nous percevons une autre réalité, tout autour de nos villes. Londres, pas plus que les régions qui vont d'Aix-la-Chapelle à Rotterdam, n'offre plus la rassurante séparation des villes et des campagnes. Partout c'est le sprawl, l'écoulement, l'étalement, urbain. Et le découvrir a été une révélation pour des générations qui n’avaient vu et appris dans leurs écoles à ne vénérer que les plans de Rome ou de Venise.
Les Trente Glorieuses nous avaient habitués à placer l’architecture sur un pied productiviste : grands ensembles, équipements, villes nouvelles; et à développer des réflexions à caractère social, en signe de notre confiance dans le progrès humain, ou comme un antidote face à ce qui se mettait en place. Les années postmodernes avaient traduit notre déception collective : retour sur l’histoire, les styles et les symboliques, la géographie et le génie des lieux, retrouvailles avec la ville ancienne et le patrimoine. Les années que nous vivons, celles de la mondialisation, du primat de l’économique et de la concurrence ont redistribué les critères : luxe, mode, hédonisme et individualisme, consommation culturelle et tourisme généralisé, exigence de compétitivité, marketing et médiatisation outrancière. D'où, souvent, une architecture spectaculaire, à la manière du Guggenheim de Bilbao (plus de quinze ans plus tard). Ici, c'est le bâtiment de Lyon-Confluence, des autrichiens de Coop Himmelbl(a)u. Ici la philharmonie de Jean Nouvel en construction à la Villette. Alors, faut-il désespérer? L'histoire de l'architecture est-elle achevée? Évidemment non (j'avais dit que je ne ferai pas de la déploration). Évidemment non, car cet art est éminemment plastique, capable de renaître sans cesse sur de nouvelles bases.
De nouvelles voies se sont ouvertes : pour des raisons techniques (avec la création virtuelle), économiques et écologiques avec notamment l’angoisse énergétique, qui implique l'isolation des
bâtiments et une construction emmitouflée (ça, c'est le côté normatif) mais développe aussi des imaginaires particuliers; pour des raisons sociales (intérêt pour les favelas, pour le recyclage, l'architecture de récupération) ; pour des raisons culturelles (avec l'internationalisation du comportement des élites, identiquement bobos d'un bout à l'autre de la planète), l'intérêt pour l'art contemporain et la grande consommation de musées et d’événements (ici le récent musée
Cocteau de Menton, de Ricciotti).
Comme la musique, comme la littérature, comme les arts plastiques, l'architecture est un art. C'est-à-dire que de toute époque, de toute situation économique ou culturelle, de tout bouleversement
technique elle fait (bon gré mal gré) son terreau, pour développer de nouvelles attitudes et déplacer ses activités. Finalement, entre un objet étonnant de Frank Gehry ou de Jean Nouvel, un moment méditatif chez Peter Zumthor, une blague de tel ou tel (car l'architecture peut aussi blaguer) et les petits bonheurs du jour, les micro-architectures (comme cette cabane maison de thé du Japonais Terunobu Fujimori), les tentatives diverses… il y a toujours place pour une réflexion ou pour une expérience spatiale ou esthétique (ou sociale). L'une des charges les plus prisées de
l’Ancien Régime était d'ailleurs celle d’architecte des Menus-Plaisirs.
François Chaslin
Pour en savoir plus
- François Chaslin, membre correspondant de la section architecture au sein de l'Académie des beaux-arts
- François-Bernard Michel sur le site de l'Académie des Beaux-arts
- Retrouvez sur Canal Académie les émissions liées à cette journée exceptionnelle du 28 novembre 2012 au sein de l'Académie des beaux-arts :
-Une Journée à l’Académie des beaux-arts : avec le sculpteur Claude Abeille
-Une Journée à l’Académie des Beaux-arts avec François-Bernard Mâche
-Exceptionnel ! Partagez une Journée à l’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS avec François-Bernard Michel
-Une Journée à l’Académie des beaux-arts avec le peintre Pierre Carron, membre de l’Institut
-Une Journée à l’Académie des beaux-arts avec Bernard Perrine
- Une journée à l’Académie des beaux-arts
Le mercredi 28 novembre, une journée de communications et de débats sur les rapports que l’Académie des beaux-arts entretient avec la création aujourd’hui.
Une journée à l’Académie des beaux-arts / Débats
- Le Programme du 28 novembre
9h30 Ouverture de la journée par Arnaud d’Hauterives, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts
10h « L’Académie des beaux-arts se présente » par Lydia Harambourg (correspondant de la section de peinture) et Robert Werner (correspondant de la section d'architecture)
14h30-17h « L’Académie des beaux-arts et la création aujourd’hui ».
Débat animé par Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, avec les interventions de :
Claude Abeille, sculpteur, graveur, membre de la section de sculpture : « L’Homme qui marche ! »
François-Bernard Mâche, compositeur, musicologue, membre de la section de composition musicale : « L’œuvre d’art est-elle obsolète ? »
François Chaslin, critique d’architecture, correspondant de la section d'architecture : « L’architecture, entre coups d’éclats et éclatement »
Bernard Perrine, photographe, éditeur associé du Journal de la Photographie, correspondant de la section photographie : « La photographie, entre modèle et banalité »
Pierre Carron, peintre, membre de la section peinture : « Hier encore, que faire ?»
17h : Conclusion par le Professeur François-Bernard Michel, Président de l’Académie des beaux-arts